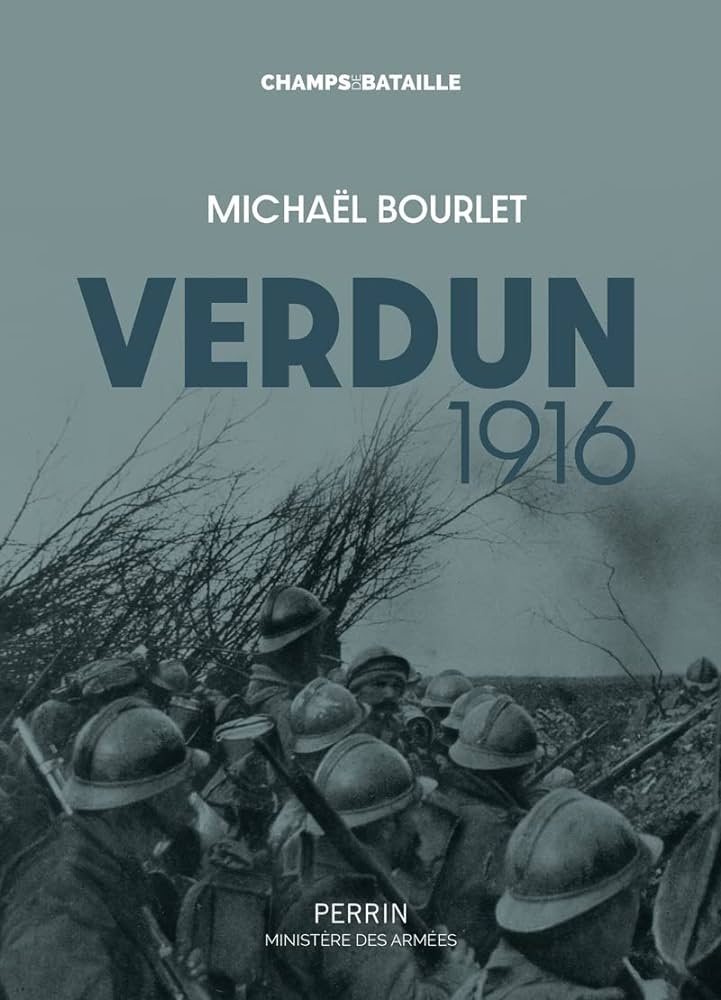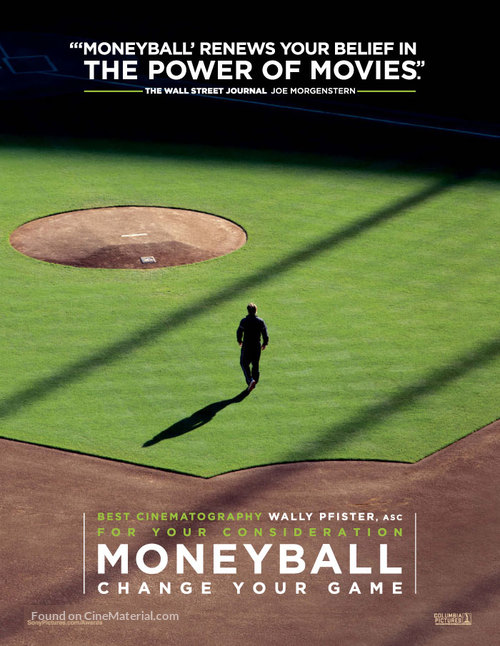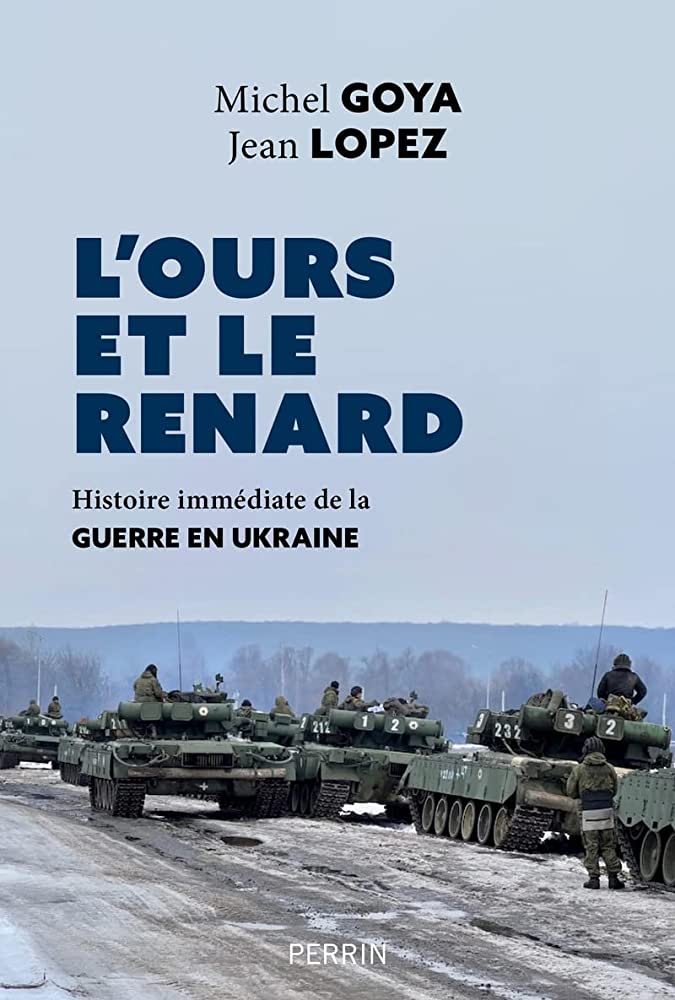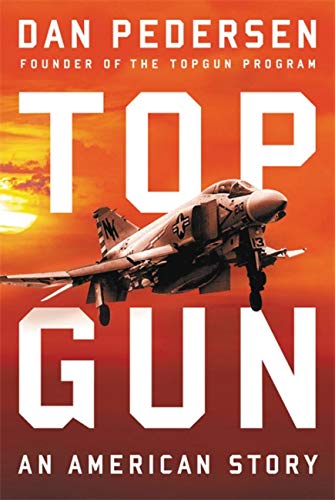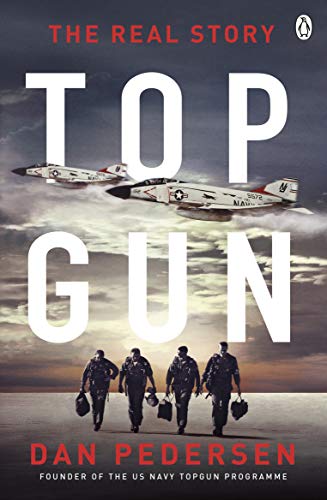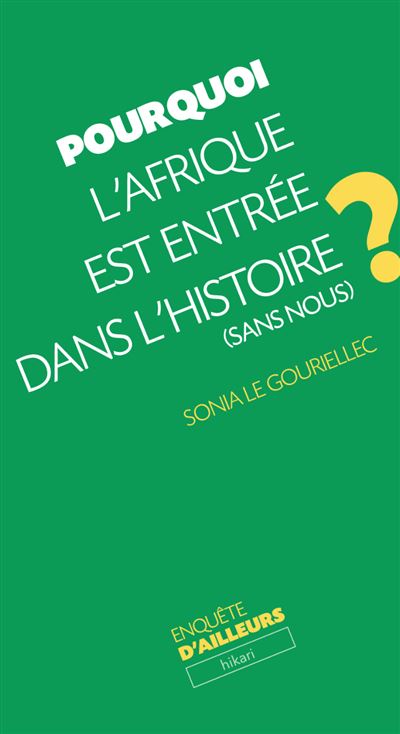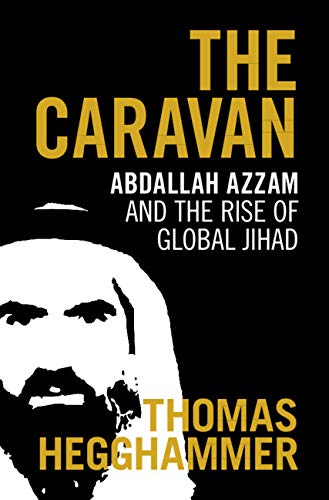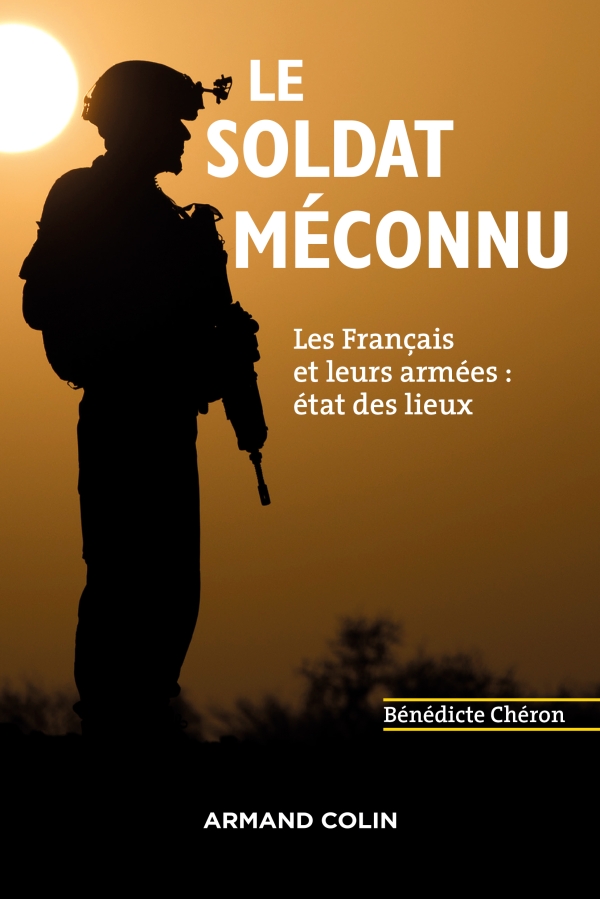Allez savoir pourquoi je me souviens de ce type, Hocine de Verviers, un islamiste algérien qui grenouillait en Belgique avec des dizaines d’autres, à trafiquer on-ne-sait-quoi pour on-ne-sait-qui. Lui et ses copains s’agitaient, voyageaient, parlaient de la guerre que menaient les maquis de l’AIS et du GIA au régime et finalement ne semblaient pas faire grand-chose pour la cause. Il émanait pourtant d’eux une menace sourde, le sentiment que ces islamistes radicaux – nous ne disions pas encore jihadistes, ça viendrait plus tard – dont nous ne parvenions pas à déterminer la nature des activités n’étaient pas que d’aimables visiteurs de passage. L’Algérie était à feu et à sang, on y tuait des étrangers, et surtout des Français ; l’Égypte affrontait une vague de violences qui n’intéressait personne ; l’Afghanistan était aux mains d’un mouvement d’étudiants ultraconservateurs ; des imams très énervés prêchaient la guerre sainte depuis Londres, et au Sahel une poignée de types parcouraient le désert en tous sens et, croyez-moi, il ne s’agissait pas de guides touristiques ou de bluesmen touaregs.
Nous n’étions qu’une vingtaine d’analystes, à cette époque, fonctionnaires A et B, officiers et sous-officiers, hommes et femmes. Nous avions tous, ou presque, la certitude, que ce que nous observions et tentions d’affronter avec des moyens dérisoires ou bridés n’avait rien d’un phénomène ponctuel. Il s’agissait bel et bien d’une révolte, sur le point de devenir une révolution, et nous n’étions pas prêts. Certains de nos chefs avaient déjà compris – dont un, aux cravates bariolées, auquel j’adresse mes respects – mais d’autres n’y entendaient rien, voire ne voulaient rien savoir. On pense à eux en relisant Marc Bloch.
Les années passant, l’analyste acharné que j’étais, et que je suis toujours, tenta dans quelques notes d’embrasser la complexité du phénomène. Les crises, les attentats, les enquêtes, les renseignements de plus en plus nombreux que nous parvenions à recueillir – grâce aux efforts surhumains de quelques-uns comme à la croissance de la mouvance islamiste qui, forcément, laissait de plus en plus de prise aux SR -, tout me donnait envie d’écrire des papiers longs et fouillés, ceux que nos autorités ne veulent pas lire mais dont elles ont besoin parce qu’ils assoient connaissance et compréhension. Mais je comprenais aussi, évidemment, que ces mêmes autorités n’avaient pas besoin de papiers para universitaires ou de récits forcément touffus mais de notes courtes, opérationnelles, les informant et les aidant à prendre des décisions. J’aime autant vous dire que tout le monde n’a toujours pas compris la différence entre un mémoire et une note de renseignement.
Il devint rapidement clair à mes yeux que ce que j’aimais faire était, d’une part enquêter et analyser (seuls les amateurs pensent qu’il s’agit de la même chose), et d’autre part écrire des papiers aux ambitions sans doute déplacées afin de comprendre la nature de ce à quoi nous étions confrontés. En 2000 me vint même l’idée d’écrire un roman sur le jihad afin de raconter par la fiction ce que je croyais avoir compris. Fort heureusement, je n’en fis rien, notamment parce que je savais que je n’en savais pas assez pour concevoir un récit ayant un minimum de tenue, et aussi parce que je suis le pire raconteur d’histoire de cette partie du monde. Il est bon, parfois, de s’abstenir.
En 2005, le travail sur le Livre blanc me permit enfin de mener officiellement une réflexion un peu poussée au sujet du jihadisme, et il m’offrit aussi l’occasion d’écrire une note de doctrine dont je reste, 20 ans après, plutôt fier. Il ne saurait y avoir d’actions concrètes, y compris violentes, sans un travail sérieux d’analyse, et il ne peut y avoir d’analyse sans un travail exigeant sur le terrain. Le Livre blanc fut le résultat de ces années de travail conjoint, et de même qu’il faut mal juger les supposés spécialistes qui affirment connaître le monde simplement en pensant à lui, il faut mépriser les supposés seigneurs du terrain (LE TERRAIN, LES GARS !) qui nous régalent de leur expérience mais ne savent pas placer correctement le y de Libye ou qui s’inventent des succès. Eux n’hésitent pas à écrire des livres, mais ils pourraient sans doute nous épargner cette souffrance en faisant preuve d’un peu de dignité.

Mon long séjour dans le secteur privé, stimulant, parfois plus opérationnel que certaines administrations, fut décidé en raison de ma volonté d’écrire dans mon coin et de me confronter à la solitude du commentateur sans moyens. D’autres motifs, complexes et personnels, m’avaient conduit à vouloir quitter pour un temps l’administration, mais il est évident que la motivation la plus importante à mes yeux fut celle de disposer d’une totale liberté de recherche et d’écriture. Ça ne fut pas toujours facile, mais j’appris beaucoup et l’homme qui me recruta alors garde mon éternelle reconnaissance.
C’est au cours de ce passage dans la consultance que je décidai de créer mon blog, et je choisis, en lecteur fidèle, d’utiliser la plate-forme du Monde. L’expérience fut d’abord frustrante (qu’écrire ? pour qui ? sous quelle forme ?) mais la discipline qu’exige la vie d’un blog me força à la rédaction de posts réguliers. Les premiers n’eurent rien de glorieux, personne ne les lisait et ils n’avaient de toute façon aucun intérêt. Mais de même que la Pythie vient en mangeant, le travail finit par payer et j’eus à nouveau le projet de rédiger un livre sur le jihadisme. La montagne me semblait cependant trop haute et je décidai de la contourner en livrant de longs textes qui, rassemblés, auraient l’ambition de porter ma compréhension du sujet. C’était un début.
Plus on travaille, plus on apprend ; et plus on apprend, plus on mesure l’immensité de ce qu’on ne sait pas encore. Il faut bien, pourtant, se lancer et c’est donc après 29 ans d’une carrière pour le moins étrange qu’est publié Et Tuez-les partout où vous les trouverez, ouvrage imparfait dont la seule ambition est d’éclairer ses lecteurs et de répondre aux foutaises que l’on subit encore trop souvent. Il a été écrit l’année dernière en se nourrissant de la colère qui caractérisa parfois le blog qu’il prolonge, en réponse à quelques figures si caractéristiques, comme ceux qui se pavanent sur les plateaux, apposent leur nom au bas de torchons qu’ils n’ont pas écrits et à peine relus, et ont réponse à tout sans même comprendre la question ; ou comme les chefs à plumes aux carrières en apparence époustouflantes qui en réalité ne comprennent rien à ce qu’ils font, travaillent à peine et nous conduisent dans le mur avec l’aveuglement que permet l’incompétence galonnée.
J’ai écrit ces pages en pensant à mes camarades, aux analystes que nous avons formés et à tous ceux qui nous ont succédé sur les remparts. J’espère que vous me lirez, les amis. Je les ai écrites en me disant que peut-être les citoyens et les citoyennes exigeants trouveraient de l’intérêt à regarder l’ennemi en face, en s’évitant les idioties habituelles (au choix : « voleurs de poule », « islamo-gangstérisme », « gna gna gna Call of Duty », « Toussa célafaute des Américains en Afghanistan », etc.). Je les ai écrites en pensant aux victimes, ici et là-bas : qui vous tue, qui vous ment, qui travaille. Nous ne baisserons jamais les bras et vous n’êtes pas seules.
Et je les ai écrites parce qu’un éditeur m’a fait l’honneur de me le proposer. Lui aussi a ma reconnaissance éternelle.