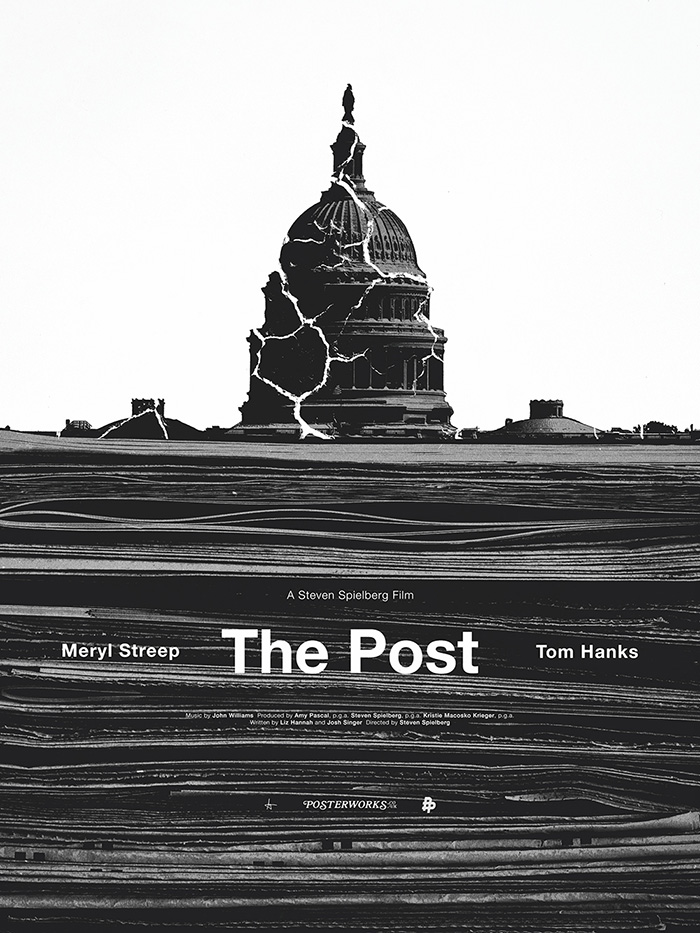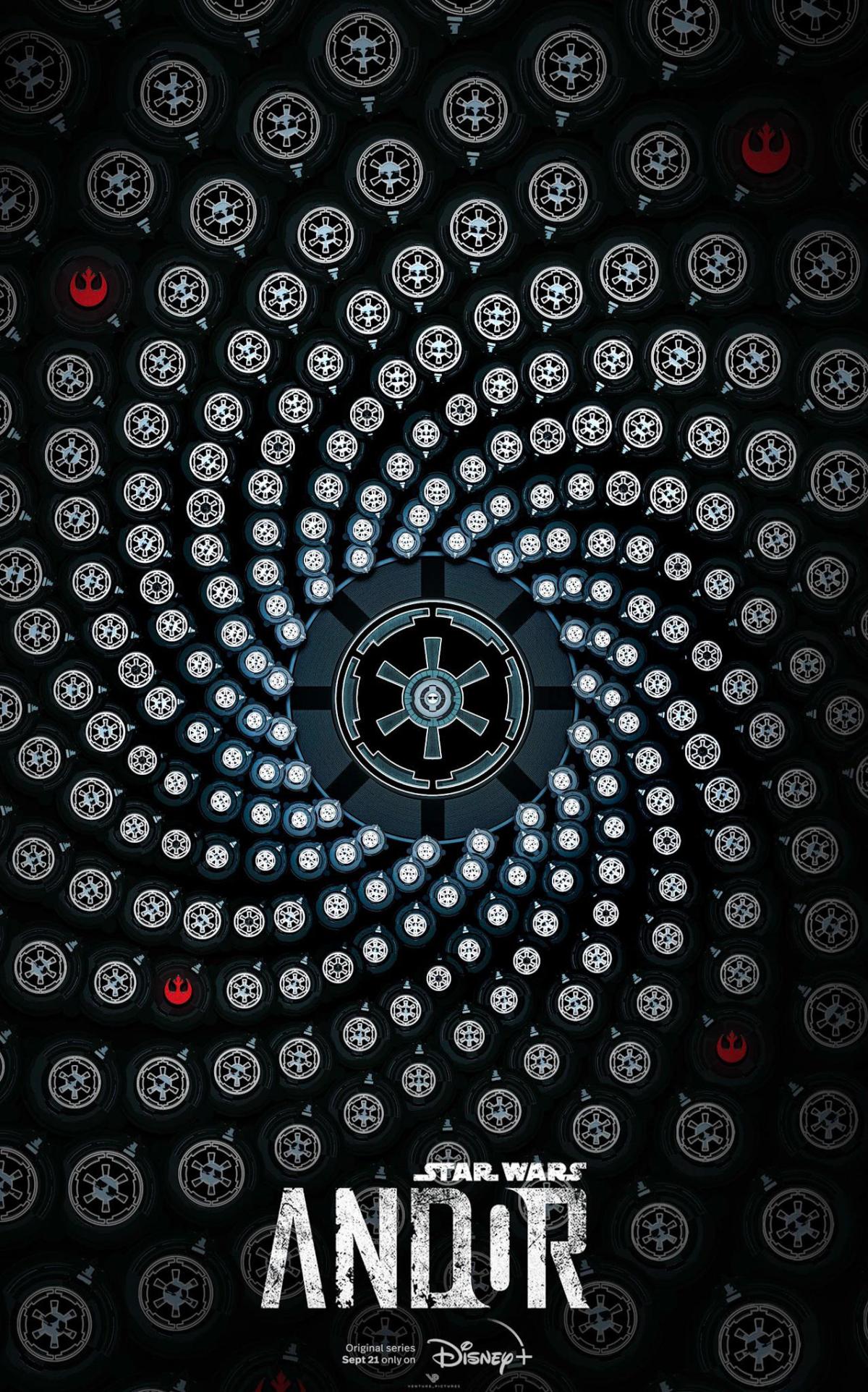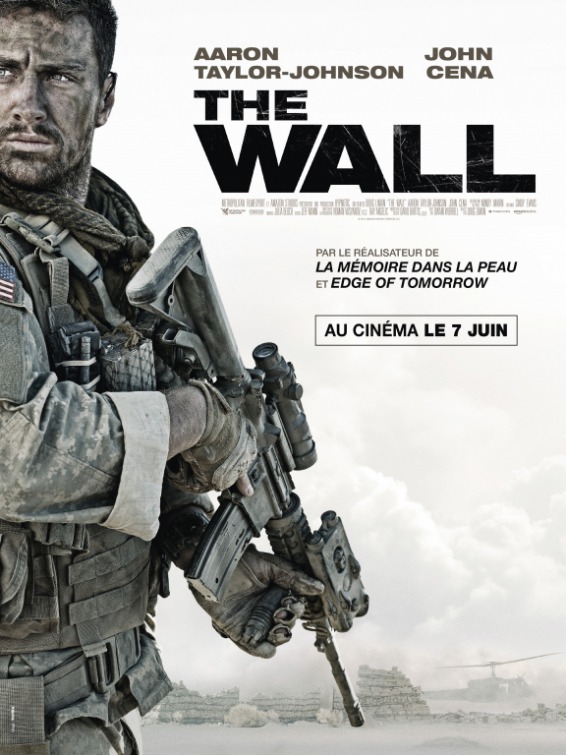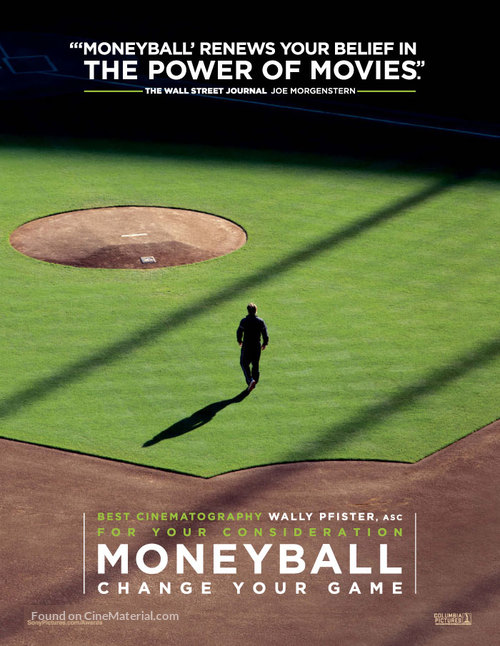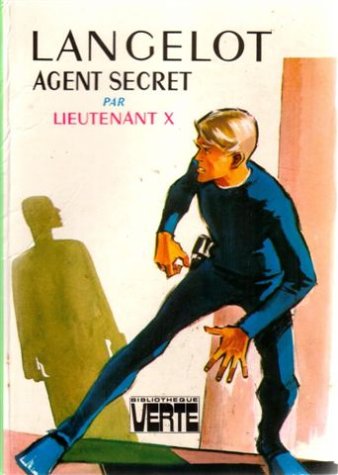Géant parmi les géants, Steven Spielberg a réalisé depuis une cinquantaine d’années quelques-uns des films les plus marquants du cinéma américain et a touché à presque tous les genres. Jusqu’en 2017, il ne s’était pourtant pas attaqué au journalisme d’investigation, sujet qui a donné et continue de donner régulièrement des œuvres remarquables au cinéma (La Dame du vendredi, 1939 ; Citizen Kane, 1941 ; L’Homme qui tua Liberty Valance, 1962 ; Profession : reporter, 1975 ; Les Hommes du président et Network : main basse sur la TV en 1976 ; L’Année de tous les dangers en 1982 ; La Déchirure, 1984 ; Salvador, 1986 ; L’Affaire Pélican, 1993 ; Révélations, 1999 ; Presque célèbre, 2000 ; Good night, and good luck, 2005 ; Green Zone, 2010 ; Spotlight, 2015) comme à la télévision (la saison 5 de The Wire, 2002 – 2008 ; The Newsroom, 2012 – 2014).
Auteur de classiques, Spielberg ne pouvait pas ne pas se mêler de journalisme et lui qui n’avait jamais traité de la Guerre du Vietnam s’est donc attaqué à la passionnante affaire des Pentagon Papers, cette gigantesque fuite de documents exposant au grand jour la réalité de la politique des Etats-Unis en Indochine puis au Vietnam et les mensonges l’ayant accompagnée.
La quintessence de ces documents fut publiée par le New York Times le 13 juin 1971 sous la plume de Neil Sheehan (qui écrira plus tard un livre indépassable sur le conflit, L’Innocence perdue) et provoqua une crise politique majeure. Steven Spielberg ne filme cependant pas l’affaire du point de vue du grand quotidien new-yorkais mais de celui de son concurrent malheureux et dépassé, le Washington Post. Le titre français est à cet égard trompeur (on ne compte plus les fois où des distributeurs français sans culture ou sans scrupules ont trahi un film en changeant son titre) : le film dans sa version originale se nomme The Post et ne cache pas son intention de traiter l’affaire depuis la capitale et non de décrire la façon dont le scoop a été géré par la rédaction du NYT.
Sans excès de mise en scène, le réalisateur s’attache à montrer comment la publication des Pentagon Papers força le Post à assumer son destin de grand titre national. L’affaire éclata en effet alors que le quotidien s’apprêtait à entrer en bourse, et le film montre comment s’opposent les tenants d’une presse audacieuse et consciente de ses responsabilités politiques (Tom Hanks, à la limite du cabotinage en Ben Bradlee, et l’immense Bob Odenkirk) et des gestionnaires et des juristes légitimement inquiets mais excessivement agaçants (Tracy Letts, Bradley Whitford ou Jesse Plemons).
Conscient de l’immense importance de la fuite de ces documents secrets, et pas moins conscient de la nécessité absolue pour son journal de se mêler de l’affaire, d’abord en se procurant les 7.000 pages du rapport McNamara puis en en publiant sa propre analyse, le rédacteur en chef tente de convaincre la propriétaire du Post, Katharine Graham (Meryl Streep, comme toujours prodigieuse), de dépasser ses préventions et de se jeter dans l’arène.
Héritière de la fortune de son mari, mal à l’aise en public, entourée de mâles dominants la trouvant au mieux très mondaine au pire, pas bien fûtée, incompétente et illégitime, Katharine Graham est le vrai sujet du film, le cœur de l’intrigue, celle sans qui le Washington Post n’aurait pas publié à son tour le rapport, ne serait pas allé défier l’Administration Nixon aux côtés du New York Times et n’aurait pas gagné devant la Cour suprême le droit de révéler des secrets honteux. Il est d’ailleurs heureux que ce combat ait été mené alors, car il n’est pas certain qu’il serait gagné aujourd’hui.
The Post, comme dit plus haut, ne traite pas tant de l’affaire des Pentagon Papers que de la transformation d’un très chic quotidien local en un titre de référence dont les articles et les enquêtes ont une portée nationale, sinon internationale. Cette transformation n’est permise que par le cheminement personnel de Katharine Graham. Le film est d’abord le récit de l’émancipation d’une femme de la très bonne société, timide, complexée, prenant conscience de son pouvoir et de ses responsabilités sans tenir compte des pressions des hommes qui l’entourent. La scène où elle sort de la Cour suprême sous le regard admiratif de jeunes américaines est à cet égard remarquable.
Parfaitement mis en scène et reprenant tous les passages obligés des films sur le journalisme (les conférences de rédaction, le rédacteur en chef en mission divine, la gestion des sources, la concurrence avec les autres titres, les plans dans la salle des rotatives, la distribution des journaux dès potron-minet, les conciliabules nocturnes, le rappel des exigences éthiques du métier), The Post est d’un admirable classicisme. Ce parti-pris de la sobriété le place à des années-lumière des outrances dont est capable Spielberg quand il le faut. Il lui permet d’être un véritable préquel du chef-d’œuvre d’Alan J. Pakula, Les Hommes du président, consacré au Watergate, le scandale qui finit par avoir raison de la présidence Nixon. Le film s’achève d’ailleurs sur la découverte du cambriolage des locaux du Parti démocrate par un vigile et on sent que Steven Spielberg fait ici un passage de relais symbolique avec un des monuments du Nouvel Hollywood.
A la perfection formelle du film s’ajoute un message politique, que les cyniques jugeront évidemment naïfs mais qu’il n’est pas inutile de rappeler ces jours-ci, au sujet du respect du bien public, de la nécessaire dignité des dirigeants et du rôle essentiel dans une démocratie d’une presse courageuse, rigoureuse et indépendante. Disons que ça va mieux en le disant.