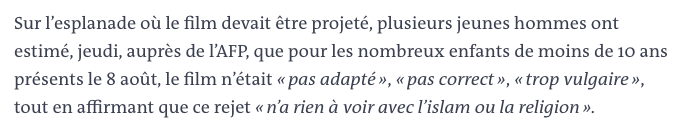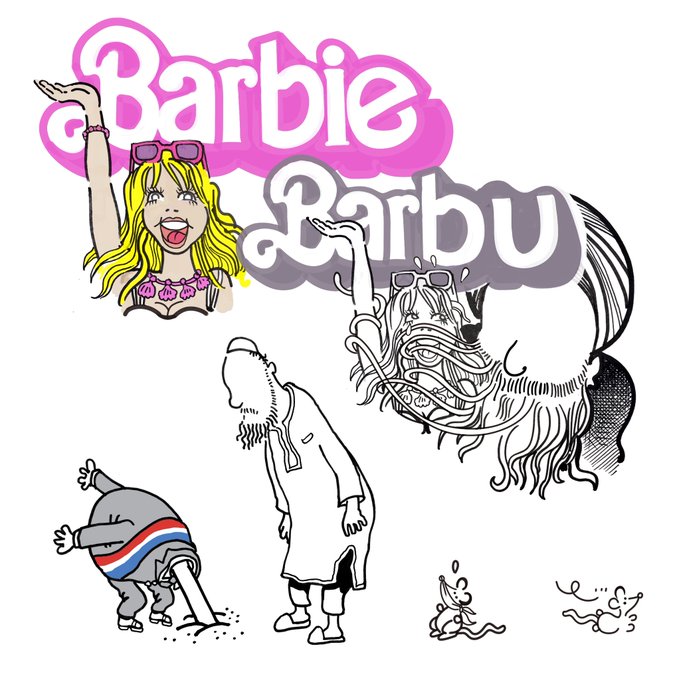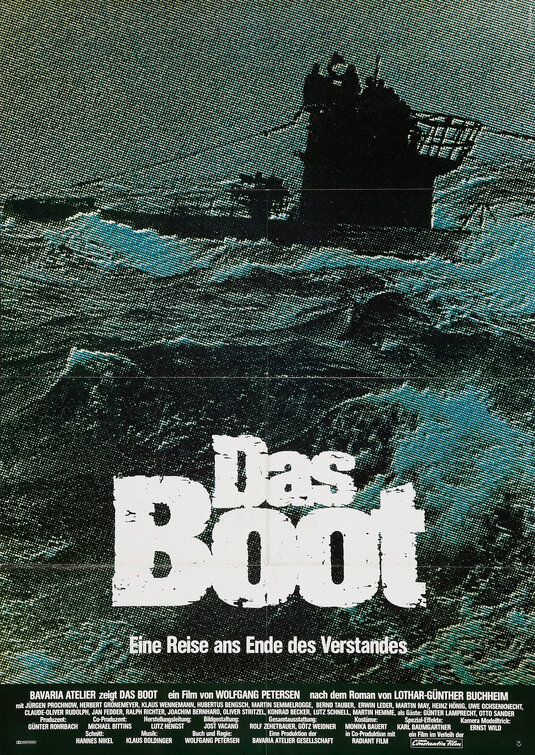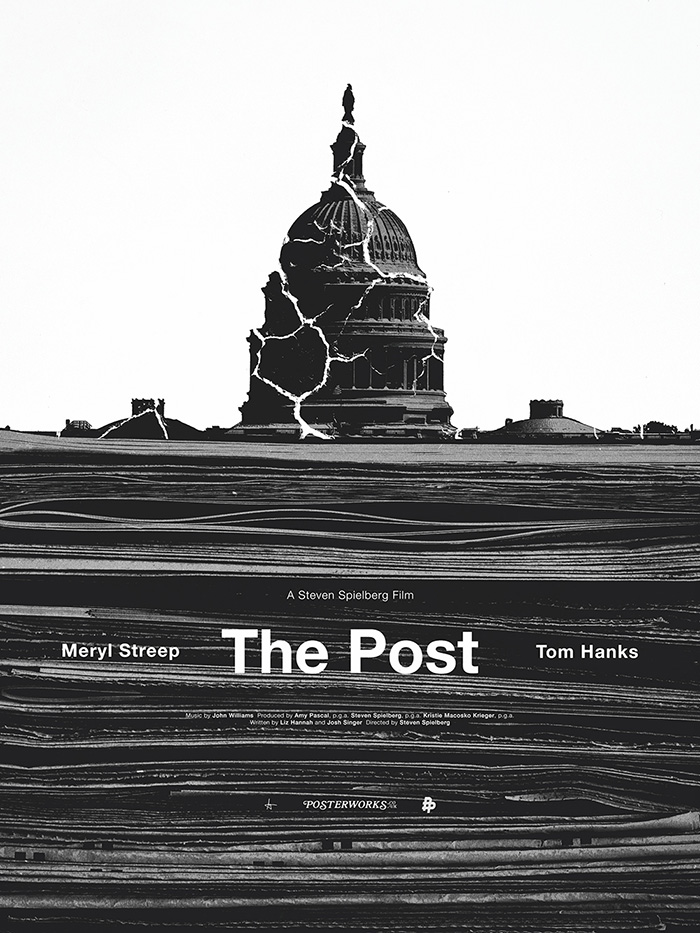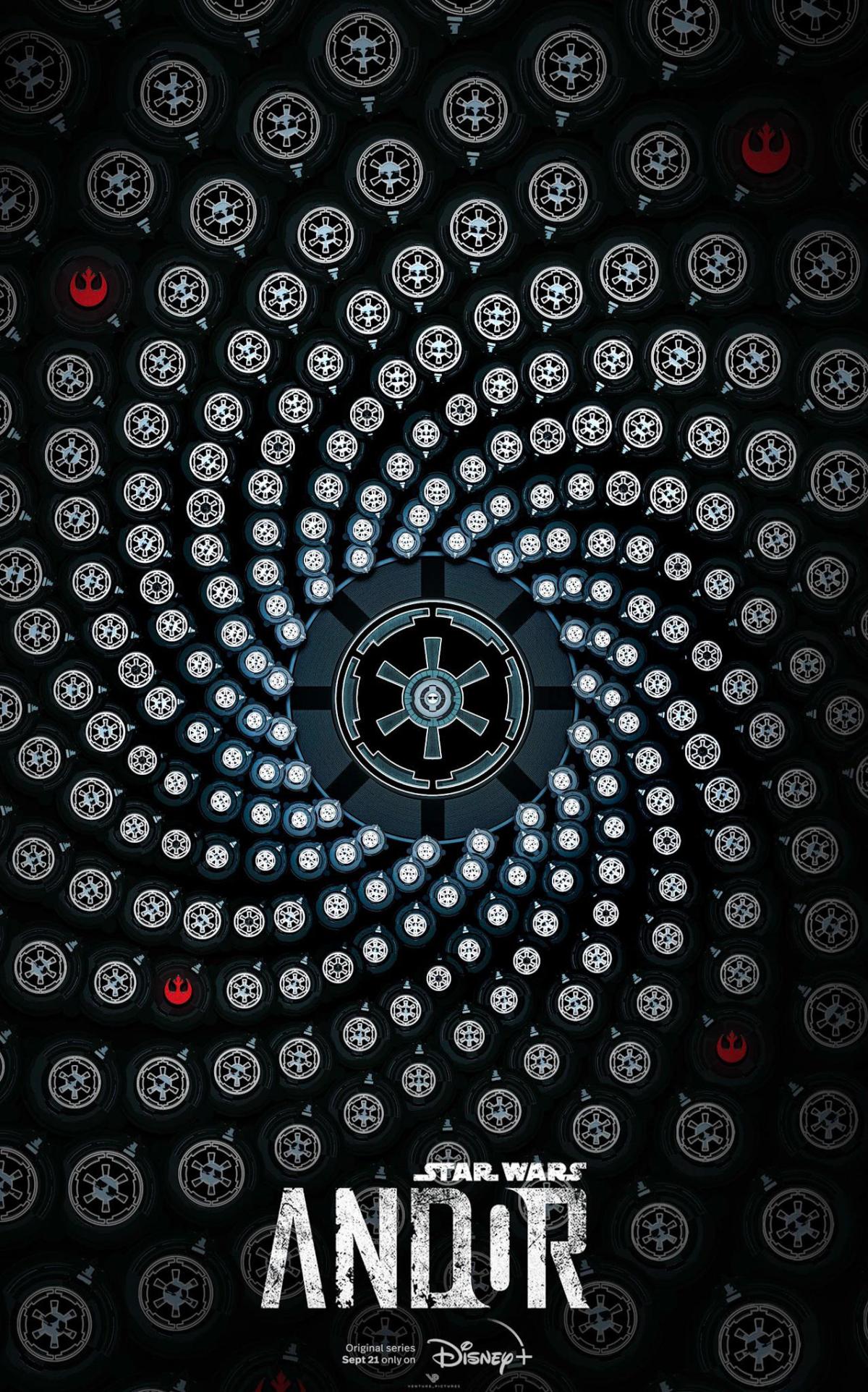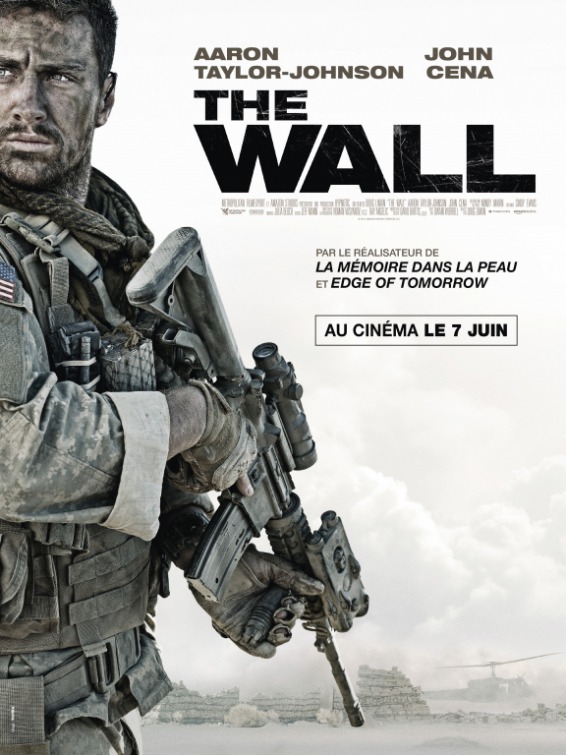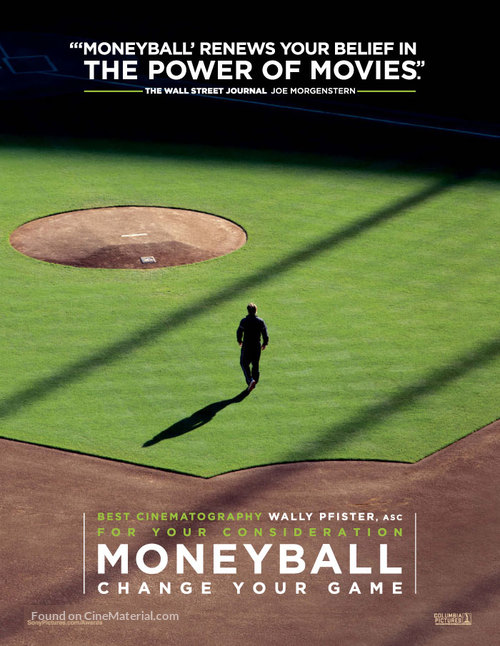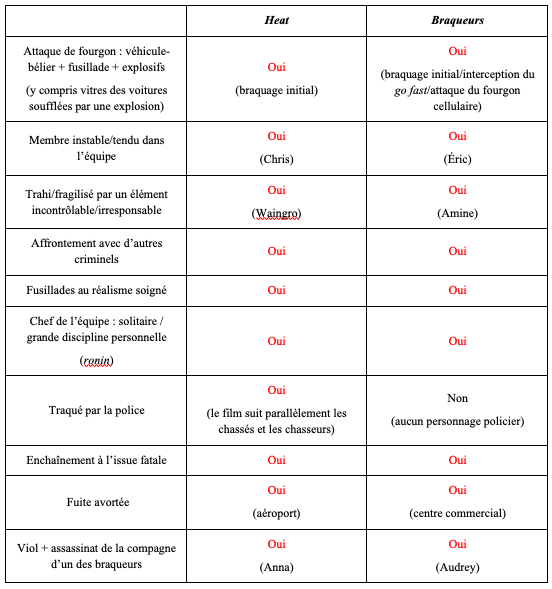Ça demande du talent et il faut en avoir envie, mais il est possible de raconter une enquête policière tout en faisant passer un message politique ou social essentiel. Les romans de Raymond Chandler, aux histoires parfois aussi trouées que la coque d’un navire russe en mer Noire, dénonçaient, dès la fin des années 30, l’hypocrisie de la grande bourgeoisie californienne, corrompue, dépravée et toute puissante. Allez savoir pourquoi j’ai l’impression que les aventures de Philip Marlowe sont d’une criante actualité. Bref, passons. Régulièrement émergent ainsi des romans noirs ou des polars dont la portée dépasse la simple intrigue en révélant la vraie nature du crime qu’ils relatent. Écrits ou réalisés avec talent et subtilité, ils ne vous assènent rien et font appel à votre intelligence et à votre conscience.
Dominik Moll a ainsi brillamment fait appel à notre intelligence et à notre conscience. avec La Nuit du 12, sorti en 2022.
inspiré d’un féminicide relaté dans le livre de Pauline Guéna 18.3. Une année à la PJ, le film de Moll raconte l’enquête, inaboutie, que conduit une équipe de policiers de Grenoble après l’assassinat, particulièrement épouvantable, d’une jeune femme dans la nuit du 12 octobre 2016. Admirablement écrit et remarquablement interprété, le récit laisse une impression durable en raison de la justesse de ses observations et de la sobriété, très maîtrisée mais jamais froide, de la mise en scène.
Depuis quand n’avions-nous pas vu un film policier français d’une telle qualité, débarrassé du pathos ridicule de certaines productions récentes et de l’influence mal digérée du cinéma américain ? Il faut sans doute remonter au film de Xavier Beauvois, Le Petit lieutenant (2005), et au classique Bertrand Tavernier L.627 (1992) pour retrouver une peinture aussi sensible et réaliste de la vie d’un groupe de policiers.
Disponible sur Disney+ et sortie en 20025, la minisérie Les Disparues de la gare semble avoir digéré l’apport du film de Dominik Moll, mais avec une intensité bien moindre.
Il est naturellement possible de ne voir dans La Nuit du 12 qu’un film d’enquête de plus, certes porté par les magnifiques acteurs que sont Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinberg et Pauline Serieys, mais sans fusillade, sans poursuite, sans plan-séquence virtuose, sans intrigue amoureuse parallèle, et donc d’une modestie finalement très européenne. Il s’agit pourtant de tout autre chose.
Dominik Moll, qui a écrit le scénario avec Gilles Marchand, signe en effet un film profondément politique. L’assassinat de Clara, dont l’auteur ne sera pas identifié, est un féminicide, c’est-à-dire le meurtre d’une femme pour la seule raisons qu’elle est une femme. Avec habileté, le récit met successivement en avant des suspects archétypaux qui, tous, représentent une forme de domination masculine : l’irresponsable, le profiteur, celui qui écrit des chansons appelant à la mort de Clara sans mesurer la portée de ses mots, l’amant violent, le bizarre.
Trop longtemps, l’enquête se concentre sur le comportement de la victime – un peu comme un partisan de la Russie expliquant, par exemple sur LinkedIn, que l’Ukraine l’a quand même bien cherché et que nous étions tous prévenus – et paraît entériner le fait qu’une femme entourée d’hommes est nécessairement, mécaniquement, logiquement, en danger et qu’elle devrait donc être prudente. Et que puisqu’elle le sait, elle est donc en partie responsable de son sort.
Ce postulat est insupportable parce qu’il fait endosser par la victime la responsabilité de son propre assassinat. Et il est insupportable parce qu’il confirme que l’homme est bien un prédateur pour la femme, manifestement un cas unique sur cette planète, ce dont les lectrices de ce blog, qui ont toutes peur dans la rue ou dans les transports le soir, qui ont toutes reçu de leurs parents des conseils de prudence dès leur enfance et qui savent toutes que le pire peut arriver sans prévenir et sans avoir été provoqué, ont parfaitement conscience ; et ce que nombre d’hommes ignorent, ne veulent pas savoir, minimisent ou – comme un partisan de la Russie expliquant, par exemple sur LinkedIn, que l’Ukraine l’a quand même bien cherché – justifient par de répugnantes théories au sujet de la nature prédatrice de l’homme ou par l’incapacité intrinsèque des mââââles à gérer leurs pulsions – le meilleur moyen de ne pas avoir à les gérer étant de ne pas en avoir et de traiter les femmes comme nos parfaites égales et non des comme des créatures inférieures, voire comme des proies. On ne saurait trop, d’ailleurs, conseiller la lecture de l’essai de Pauline Harmange, Moi les hommes, je les déteste (2020), édifiant.
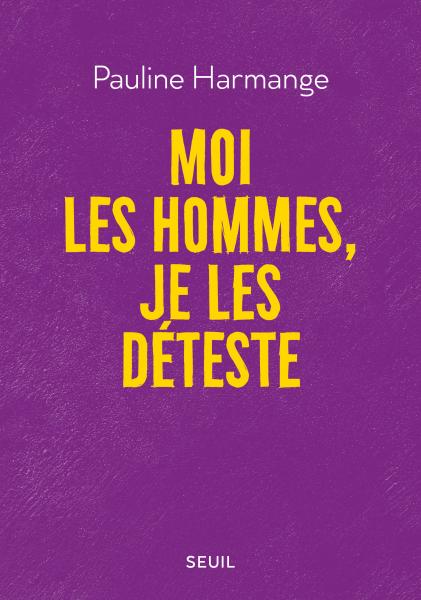
A la fin du film, la seule policière de l’équipe, nouvellement affectée à l’enquête, fait, alors qu’une séance de planque s’éternise, une réflexion vertigineuse : « Vous ne trouvez pas ça bizarre que ce soit majoritairement les hommes qui commettent les crimes et majoritairement les hommes qui sont censés les résoudre ? Les hommes tuent, les hommes font la police. C’est curieux, non ? »
Reçu par la juge d’instruction, qu’Anoux Grinberg incarne admirablement, le principal policier de l’enquête confie son impuissance à confondre ou à écarter les suspects et déclare à la magistrate : « Je suis convaincu que si on ne trouve pas l’assassin, c’est parce que ce sont tous les hommes qui ont tué Clara. »
Plus qu’un aveu collectif, cette phrase est le constat accablé d’un homme droit, confronté à un échec collectif. Jamais moralisateur, le film de Dominik Moll évite les lourdes démonstrations et sa sobriété est ainsi une marque de respect adressée à Clara et aux innombrables victimes.