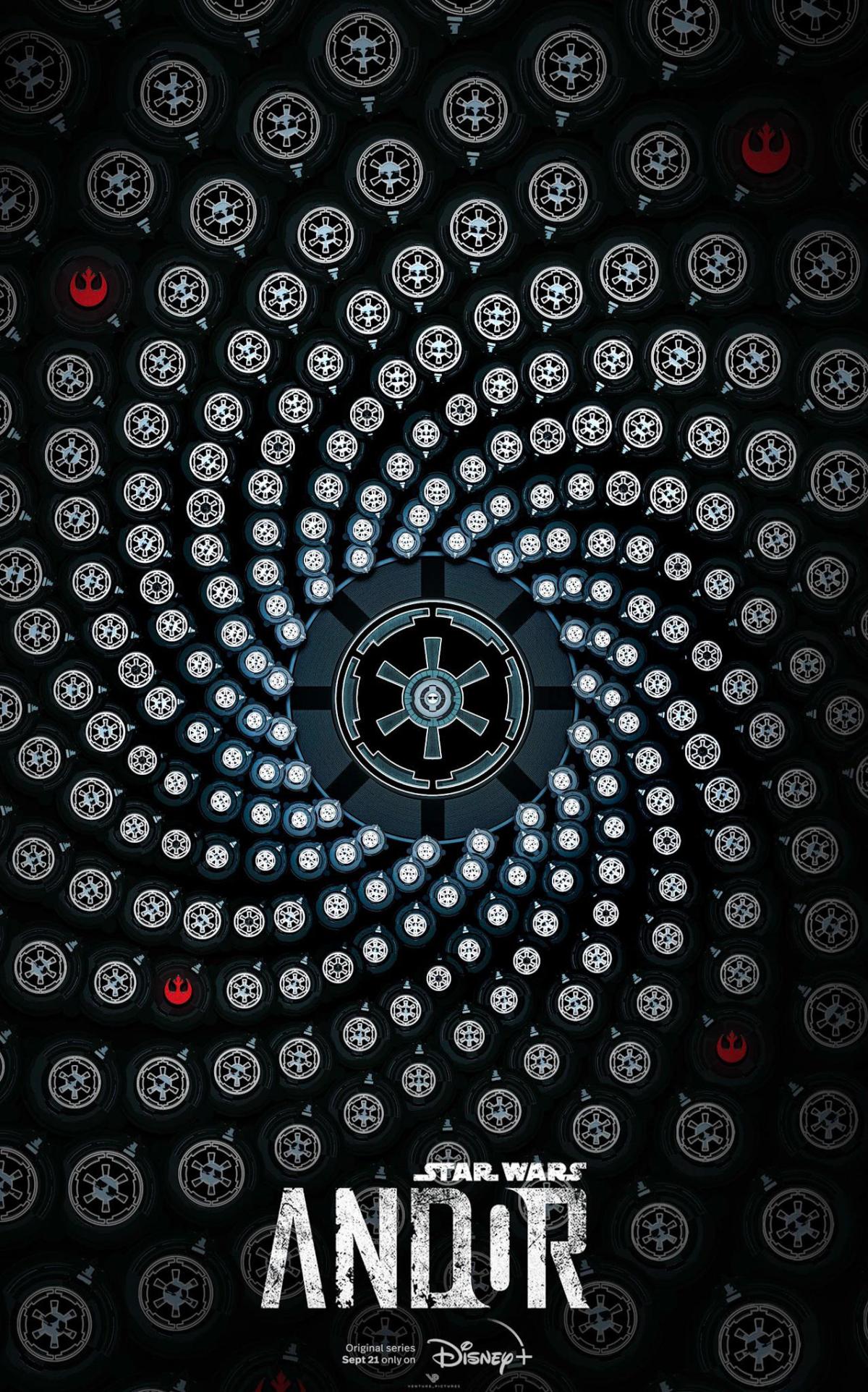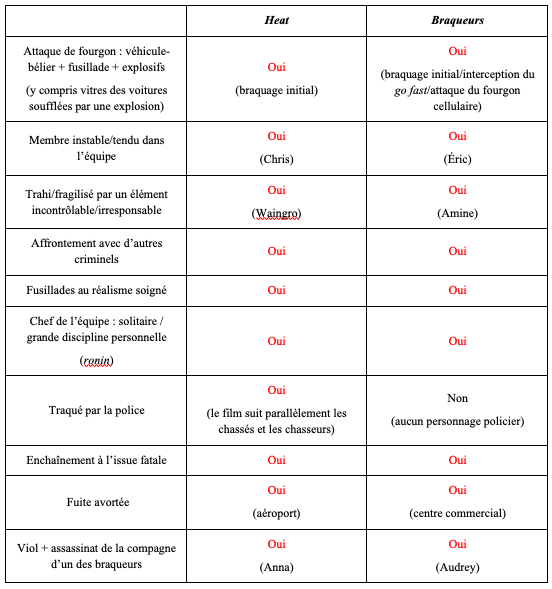Un ami très cher me disait il y a peu qu’on pouvait ne pas être d’accord avec la ligne de Mediapart sur de nombreux sujets, comme c’était son cas, mais qu’il fallait considérer sa rédaction comme un trésor national en raison des nombreuses affaires qu’elle exhumait, inlassablement, des profondeurs de la République.
A partir de 2016, sous la plume de Fabrice Arfi et de quelques autres esprits très affutés de Mediapart a donc été exposée en détails la complexe et faramineuse affaire dite de la taxe carbone. D’une ampleur inédite, cette escroquerie a ensuite été relatée par Arfi lui-même dans un livre remarquable, D’Argent et de sang, publié en 2018 au Seuil.
De prime abord, le texte peut dérouter en raison de son ton très personnel. L’auteur y expose les faits avec précision et clarté mais y mêle aussi des souvenirs plus intimes et le récit de ses entretiens avec certains des protagonistes. On a même la désagréable surprise d’y croiser un toutologue bien connu qui démontre qu’il avait peut-être des trucs intéressants à dire quand il se cantonnait à son sujet (mais ça c’était avant). Reste que le livre est passionnant et limpide et qu’on y mesure l’étendue du « fiasco d’État », selon l’expression d’un des acteurs de l’affaire qui y voit « une arrogance, un aveuglement, une inconséquence sidérante, une bêtise incommensurable ». Vous pouvez imaginer à quel point j’ai été sensible à cette description.
Fascinante, l’escroquerie a inspiré à Olivier Marchal un film, Carbone, sorti en 2017, avec Benoît Magimel, Gérard Depardieu, Laura Smet et Michaël Youn (étonnamment sobre et convaincant).
Le résultat, évidemment lourdingue, a été vite vu et vite oublié. L’histoire, de toute façon, méritait mieux et une ambitieuse série en 12 épisodes, réalisée par Xavier Giannoli, un cinéaste talentueux et expérimenté, et Frédéric Planchon, venu du monde du clip, et produite par Canal+, a été tournée entre octobre 2021 et octobre 2022. Saluée par la critique, qui a admiré les moyens, certes conséquents, déployés, et la performance de certains acteurs, elle s’est pourtant révélée décevante, et parfois même pénible.
Précisons ici que la série ne se veut pas une adaptation fidèle du livre de Fabrice Arfi. Elle y puise en revanche le matériau pour relater les origines et la mise en œuvre de l’escroquerie puis les péripéties de sa gestion par ses auteurs. Afin de donner un fil conducteur au récit, les scénaristes ont choisi de suivre un personnage fictif, Simon Weynachter, le chef de la Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF), fusion de plusieurs enquêteurs comme l’est Maya dans Zero Dark Thirty.
Weynachter livre donc son récit à l’occasion d’une audition devant une commission d’enquête à laquelle il est difficile de croire, et sa déposition devient la voix off qui accompagne le spectateur le long de 12 épisodes. L’idée est bonne, et on a vu de tels procédés à plusieurs reprises. Dans la remarquable série de Netflix (post à venir) Narcos (2015-2017), par exemple, ce que nous voyons est commenté par les voix de Steve Murphy et Javier Peña, les deux agents de la DEA au cœur de la traque de Pablo Escobar puis de celle des « gentilhommes de Cali ».
Martin Scorsese l’a également utilisée à plusieurs reprises, avec sa virtuosité habituelle, notamment dans Les Affranchis (1990),
puis dans un autre chef-d’œuvre, le monumental Le Loup de Wall Street (2013).
Et, évidemment, il faut garder en tête l’extraordinaire séquence d’ouverture d’Apocalypse Now (1979), un des plus grands films jamais tournés.
Dans ces exemples, si la voix off est bien celle d’un protagoniste, elle adopte une attitude distanciée, comme chez Coppola ; cynique ou ironique chez Scorsese ; ou froidement descriptive dans Narcos. Dans la série de Canal, au contraire, le narrateur nous sermonne, nous livre une leçon de morale très appuyée comme si nous étions incapables de comprendre sans l’aide d’un monologue lourdingue à quel point ces escrocs sont des criminels d’une particulière indécence, à quel point certains hauts fonctionnaires ont été des irresponsables, à quel point certaines banques ont été d’une telle indulgence qu’elles sont devenues des complices, et, in fine, à quel point ces méchants sont très méchants. Au moins, reconnaissons-le, chez Olivier Marchal, on nous épargne les leçons de morale pour esprits ralentis et on nous laisse seuls juges de ce que nous voyons.
Non, vraiment, ça n’a rien de magistral. Le texte est inutilement insistant et il est joué avec une emphase qui le dessert, comme un sermon dans un pensionnat religieux. Il est pourtant possible de dénoncer rien qu’en montrant, comme le firent les maîtres du Nouvel Hollywood dans les années 70, ou en 2011 J.C. Chandor dans Margin Call, critique d’une infinie cruauté du monde de la grande finance dépourvue de la moindre diatribe.
On pensait que la leçon avait été retenue depuis longtemps : plus vous expliquez ce que vous montrez, plus c’est pénible ; et partir du principe que vos spectateurs ont besoin qu’on leur dise ce qu’ils doivent penser révèle tout le mépris que vous avez pour eux, peut-être même sans en être conscient. Bref, la série, malgré les performances remarquables de Ramzy Bedia et de Niels Schneider, évoque une interminable soirée des défunts Dossiers de l’écran auxquels on aurait greffé quelques scènes d’orgie empruntées à Martin Scorsese.
Il faut dire que 12 épisodes, c’est long, très long, qui plus est alourdis par une intrigue parallèle (Vincent Lindon, sa fille toxicomane et son petit ami, parasite méprisable) supposée apporter de la profondeur au personnage principal mais qui n’est en fait qu’une touche de mièvrerie sans intérêt. Il faut, à un certain point, choisir entre le récit d’une enquête ou le portrait d’un personnage. Et, figurez-vous qu’il semble possible de se concentrer sur l’un tout en dessinant l’autre en creux (on pense encore une fois à Zero Dark Thirty, mais les exemples sont innombrables, comme dans L’Armée des ombres de Jean-Pierre Melville en 1969). L’ensemble n’est certes pas déplaisant mais n’a rien d’inoubliable et il est surtout conseillé de lire le livre de Fabrice Arfi.