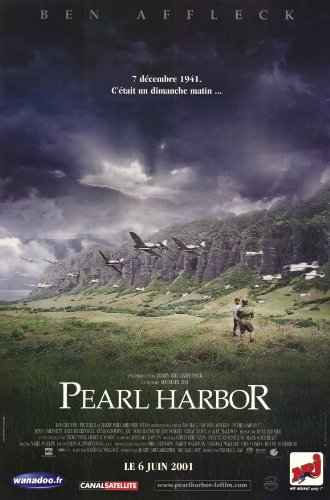Le 14 mars, le Président français et le Premier ministre britannique ont annoncé qu’ils réfléchissaient sérieusement à livrer des armes à la rébellion syrienne. Aussitôt, et comme prévu, les habituels cris d’orfraie se sont élevés, de ci de là. « Paris arme des terroristes », « La France arme en Syrie ceux qu’elle combat au Mali », « Les Occidentaux veulent abattre le dernier régime laïc du Moyen-Orient », et patati et patata.
Je ne vais pas essayer de dire en moins bien ce que le blog Un oeil sur la Syrie a écrit il y a quelques jours, ni tenter de répondre à ceux qui, engoncés dans leurs certitudes, prennent un air goguenard, ne pensent qu’aux – hypothétiques – contrats de reconstruction et ne voient dans tout cela que les manœuvres du grand capital mondialisé aux mains d’une élite apatride et décadente. Ceux-là, en vérité, on ne perd même pas de temps à les mépriser.

Avant de revenir sur cette épineuse question de livraison d’armes, il ne me semble pas inutile de prendre un peu de champ et de regarder tout cela de haut. Comme je l’ai écrit il y a déjà bien longtemps, alors que j’étais au Caire, les révoltes arabes, déclenchées en décembre 2010 en Tunisie et qui couvaient depuis au moins 2008, illustrent, parmi d’autres phénomènes, le lent basculement de puissance occidental engagé depuis des années. Et toutes ces révoltes, comme la guerre au Mali, peuvent être lues comme des crises postcoloniales nourries par des frontières absurdes et le jeu des puissances régionales et mondiales.
Souvenons-nous de l’Empire ottoman, de sa domination plus ou moins réelle sur l’ensemble du monde arabe. Souvenons-vous de l’Homme malade de l’Europe, vaincu et dépecé par ceux qui, au nom de la défense de la nation, choisirent sans vergogne de nier la nation arabe et, en Egypte, en Syrie, en Libye, imposèrent une domination européenne plus ou moins violente mais toujours illégitime. Souvenons-nous des fameux quatorze points du président Wilson, et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Cause toujours, Woodrow.
Après s’être massacrés pour l’Alsace, la Lorraine ou la Serbie, les Européens ont donc soigneusement tracé des frontières au Moyen-Orient pour des motifs qui, stratégiquement et économiquement valables, n’en étaient pas moins des aberrations pour les peuples, quand il ne s’agissait pas simplement de violation de la parole donnée. Demandez à Thomas Edward Lawrence ce qu’il en pense. En Irak, en Turquie, en Syrie, en Iran, la question kurde n’a cessé de provoquer de violentes crises intérieures. On a vu des véritables insurrections à Oman, et au Yémen, et la question du Darfour n’est pas autre chose, tout comme celle du Sahara occidental. Dans une région qui avait été organisée sous forme de principautés gérées de loin par la Turquie, la création d’Etats plus ou moins nationaux par des Européens qui ne lisaient pas les cartes de peuplement ne pouvait que provoquer, à terme, de terribles conflits communautaires.
Pendant près d’un siècle, le système régional instauré au Moyen-Orient, et même, soyons fous, du Maroc à l’Iran, a pourtant fonctionné. Il a, certes, été très violemment secoué, par la création d’Israël comme par des poussées irrédentistes en Irak ou au Yémen – sans parler de la crise libanaise, sans fin, mais il a tenu. Je ne peux que vous renvoyer aux lumineux écrits d’Henry Laurens pour le détail de ces processus, et aux atlas de Philippe Lemarchand ou de Jean et André Sellier. Le fait est que l’affrontement des blocs a, au Moyen-Orient comme en Afrique, gelé les frontières et écrasé les peuples au gré de leurs révoltes, récupérées du Kurdistan au Sahara en passant par le Balouchistan ou le Sinaï.

Les crises qui se succèdent depuis la dislocation de l’empire soviétique ne sont que la libération de forces qui pendant des décennies avaient été étouffées et qui, comme on a pu le voir ailleurs (par exemple, dans les Balkans), avaient gagné en vigueur au lieu de s’étioler. L’Histoire nous montre que les peuples doivent d’abord faire l’expérience de leur indépendance, fut-elle sourcilleuse, voire même agressive, avant de s’engager dans d’autres aventures. Le Moyen-Orient, comme l’Afrique, a vu ses indépendances confisquées par des régimes militaires qui ont presque atteint la grandeur (en Egypte ou en Irak, malgré le caractère épouvantablement répressif de ces régimes) mais ont surtout touché la médiocrité (Algérie, Tunisie, Syrie, Libye, Yémen). Il est normal que ces pulsions autonomistes, que l’Empire a libéré éesen Irak en 1991 au Kurdistan (mais a sacrifiées au nord), s’expriment désormais. Elles ont, après tout, entrainé la chute du colonel Kadhafi selon un schéma (poids des tribus de Benghazi) qui avait été envisagé de longue date et qu’on a pu observer au grand jour lors de l’affaire des infirmières bulgares.
A ces poussées irrédentistes se sont, fort légitimement, ajoutées des revendications sociales et politiques. Il faut dire que ces Etats, dont certains nous vantent la stabilité et qu’on nous reproche de vouloir abattre, sont de spectaculaires échecs, de véritables naufrages humains – et il suffit, pour s’en assurer, de jeter un œil sur les données du rapport 2012 de l’indice de développement humain. Pas de quoi pavoiser, les gars, vraiment pas.
Selon des lois historiques connues de tous, l’échec intérieur conduit souvent à une diplomatie aventureuse, à une posture agressive. Depuis les années ’60, combien de guerres entre Etats du Moyen-Orient, combien de manipulations nauséabondes, parfois sur le dos de causes justes et sacrifiées, comme celle de la Palestine ? Des ruptures au sein du Baas aux groupes palestiniens dissidents, des projets d’union qui finissent par une guerre dans le sable entre la Libye et l’Egypte aux opposants soutenus là et massacrés ici avant qu’on ne change d’avis et de camp, la région, aux ressources si importantes, à la culture si riche, à l’histoire si ancienne, n’est qu’un champ de ruines.
Prenons la Syrie, par exemple. On ne nous parle que d’Etat nation, mais le fait est que le pays est d’abord, comme en Irak, comme à Bahreïn, gouverné par une minorité qui s’appuie sur d’autres groupes minoritaires. L’exercice est en soi périlleux, mais quand il tourne à l’économie prédatrice, au régime policier et à la puissance régionale déstabilisatrice, autant dire que ça fait quand même beaucoup. On aura beau jeu de rappeler que non contents d’avoir soustrait le Liban aux Ottomans au 19e siècle, les Français en ont fait progressivement un Etat qui ne pouvait qu’attiser les convoitises de la Syrie, pour laquelle il est toujours un chiffon rouge. Coupable inconséquence que voilà, mais comme d’habitude, me direz-vous.
Alliée de Moscou et de Téhéran pour des raisons idéologiques et stratégiques, la Syrie de ces trente dernières années est un des ennemis les plus clairement identifiés des pays occidentaux, dont elle a tué avec une admirable constance les diplomates, les soldats, les journalistes, les citoyens ordinaires. Qui se souvient qu’en 1989 l’Assemblée nationale discutait d’une guerre contre la Syrie pour sauver le général Aoun ? Qui se souvient que nous avons mené aux services syriens une guerre plus ou moins secrète à Beyrouth dans les années ’80 ? Qui se souvient de Louis Delamare, assassiné en 1981 ou des agents de la DGSE flingués à la surprise ?
En 1990, découvrant les vertus des Nations unies, le régime syrien se rallia à la coalition impériale contre l’Irak mais ne cessa, tout au long des années ’90, de tolérer sur son sol des jihadistes qui partaient, via l’Iran ami, en Afghanistan ou se radicalisaient dans quelques mosquées particulièrement gratinées de Damas. Après 2001, la Syrie prit conscience de l’horreur du terrorisme (« Oh, toute cette violence, c’est mal », aurait dit Bachar El Assad) et se décida à coopérer pleinement contre Al Qaïda. En 2003, le même, sincèrement outré par l’invasion de l’Irak que son père avait soutenue plus de dix ans auparavant, aida alors les jihadistes du monde à mener dans le pays, contre les troupes impériales, une campagne de terreur que certains responsables occidentaux en vinrent à qualifier d’industrielle. Quelques opérations à la frontière convainquirent celui qui avait laissé se développer le printemps de Damas de cesser cette aventureuse diplomatie. En 2005, le même, que l’on nous présente comme un modèle, comme un chef d’Etat responsable navigant dans un océan déchainé, a – au moins – laissé se commettre l’assassinat de Rafiq Hariri puis a autorisé une campagne d’assassinats ciblés à Beyrouth contre des députés et des journalistes (Note pour plus tard : essayer de comprendre pourquoi la mort lors d’un raid de drone d’un émir d’Al Qaïda est infiniment plus révoltante que celle d’un intellectuel libanais aux yeux de certains défenseurs du droit et de la justice).
Ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain, et assurons ici clairement que le peuple syrien, otage d’une dictature ubuesque, n’est pas l’ennemi. Mais osons dire, tout aussi clairement, que le régime syrien, qui n’a jamais JAMAIS fait preuve de la moindre honnêteté, qui a trahi ses alliés, sacrifié ses obligés, changé de camp tous les dix ans, écrasé son peuple, est un ennemi. Un de ces ennemis puissants, qu’il faut renverser avec prudence, mais dont la chute serait une si bonne chose. Ceci étant posé, pour le champagne, on va attendre un peu.
Seul allié de l’Iran, base arrière du Hamas, soutien proche du Hezbollah, encombrant protecteur, à la manière d’un membre de la famille Soprano, du Liban, voisin imprévisible d’Israël et de la Turquie, client fidèle de la Russie, le régime syrien est un élément bloquant du Moyen-Orient. Sans exonérer le moins du monde Israël de ses responsabilités, force est de reconnaître que la Syrie n’est pas un partenaire pour la paix, dans aucune de ces zones d’une région qui aurait tant besoin, pourtant, de ne plus entendre les bombes et de voir grandir ses enfants.
Ainsi donc, nous allons (essayer de) donner des armes aux rebelles syriens. La décision, courageuse, est à la fois tardive et aventureuse. Tardive car il nous aura donc fallu deux ans pour réaliser que Bachar Al Assad, dont on ne doit pas nier ici la volonté farouche, ne lâchera pas et qu’il continuera à tirer des Scud (oui, pas des Hellfire) sur ses villes, à lancer des milices (le simple terme fait frissonner) sur son peuple, à accepter les viols en prison ou la torture des enfants. Et il le fera avec d’autant plus d’aisance que ses deux – seuls – alliés, la Russie et l’Iran, lui fournissent sans limite armes, munitions, équipements et conseillers.
Face à cette violence sans limite qui révèle une volonté sans faille, les rebelles paraissent bien démunis. A Paris, on considère que le régime n’est pas en danger et que les insurgés, désorganisés, sans leader, sans ligne, sont dans une impasse. Laissons de côté les imposteurs et autres vieux cons qui proclament, contre toute évidence, que la révolte syrienne est une manœuvre américaine, et essayons de ne pas vomir alors que quelques anciens hauts fonctionnaires qui connaissent tout de la nature du régime syrien tentent désormais de l’absoudre en tordant la vérité. La révolution syrienne s’est radicalisée en raison de l’extrême violence de la répression. Et disons-le tout net, Bachar Al Assad n’avait pas d’autre choix que de frapper très fort : il ne pouvait faire aucune concession, aussi bien pour des raisons internes qu’externes, et il a, techniquement parlant, eu raison de jouer la surenchère. Après tout, on sait qu’il n’est guère sensible aux arguments moraux, et lui sait l’étendue de notre impuissance.
Avec 4.000 hommes au Mali, contre un ennemi intrinsèquement isolé, la France fait un effort à la fois admirable et presque trop grand. Que dire, alors, d’une intervention directe contre la Syrie ? Qui a envie de défier un Etat qui peut embraser toute la région ? Qui a envie de s’en prendre à une armée équipée par Moscou et conseillée par Téhéran ? Qui a envie d’entraîner dans la fournaise la Jordanie, le Liban, l’Irak et la Turquie ?
Qui ? me direz-vous. Mais, les jihadistes bien sûr. Dès mai 2011, les premiers combattants étrangers s’invitent dans le conflit. Ils viennent d’Irak (où ils étaient entrés grâce aux Syriens, mais chut, puisqu’on vous dit que le régime de Damas est une victime innocente), d’Afghanistan, du Caucase, et bientôt du Nord Liban. Ils viennent mener une nouvelle guerre sainte contre un régime honni, ils viennent créer le chaos, ils viennent tenter de refaire le coup de l’Irak en récupérant une lutte nationale pour en faire l’œil d’un cyclone.
Deux ans plus tard, les jihadistes syriens sont la composante la plus visible et sans doute la plus efficace et la mieux organisée de l’insurrection syrienne. On trouve dans les rangs du Jabhat Al Nusra des volontaires tunisiens, libyens, égyptiens, irakiens, afghans, et on voit avec effroi se constituer un nouveau foyer du jihad mondial dont l’ambition va bien au-delà de la Syrie. A Amman et à Beyrouth, on sait ce qu’il faut craindre de ces hommes, jihadistes, terroristes, soutenus par les pétrothéocraties qui rêvent d’en finir avec Damas.

Et nous ? Nous, nous avons hésité, nous avons mesuré notre impuissance, nous avons découvert, candides que nous sommes, que la Russie, qui en vingt ans a déjà perdu l’Irak, la Libye et le Yémen, ne laisserait pas disparaître son dernier allié arabe. Et nous avons réalisé, naïfs que nous sommes, que l’Iran, déjà isolé, ne pouvait pas se permettre de perdre son alter-ego, et son seul allié arabe. Et nous avons aussi compris que le régime syrien, qui donnait une leçon de froide détermination, devait tomber pour éviter qu’il ne se venge. Devoir moral initial, la chute de Bachar Al Assad est devenue un impératif stratégique, et aussi, en passant, une nouvelle étape du détricotage du vieux système international dont je parle depuis des années.
Comme je l’ai déjà écrit, par ailleurs, il va être difficile de me présenter comme un partisan de l’islamisme radical ou un admirateur des jihadistes. Pour tout dire, je partage même les craintes de certains, mais je ne mélange pas tout. Je sais lire une chronologie, par exemple, et je sais que la révolution syrienne n’a pas été déclenchée par les jihadistes. Et je sais aussi que tous les insurgés syriens ne sont pas des jihadistes. Avoir entendu, aujourd’hui, un nouvel escroc dire que la France combattait au Mali ceux qu’elle armait en Syrie m’a donné envie de hurler. La révolte syrienne est plurielle, et tous ceux qui sont allés sur le terrain connaissent l’infinie complexité des crises. Où a-t-on déjà vu une insurrection homogène ? Où a-t-on déjà vu une guerre civile sans des dizaines de groupes armés, parfois alliés, parfois concurrents ?
La révolution syrienne, qui est devenue une guerre civile, n’échappe pas à la règle. On y trouve des milices communautaires et des milices gouvernementales, on y trouve une Armée syrienne libre (ASL) éclaté en commandements locaux, et des jihadistes, arabes ou tchétchènes. La Syrie est un chaos, peut-être le pire merdier de cette planète, et le choix d’armer – ce qui n’est pas encore fait – l’ASL ne revient évidemment pas à armer le Jabhat Al Nusra. Ceux qui affirment ça sont, soit des idiots, soit des menteurs, soit de malheureux racistes qui pensent que chaque révolutionnaire arabe est un jihadiste. Un peu comme si en 1943 les Britanniques avaient dit que tous les résistants français étaient des communistes ou des monarchistes ou des républicains. Comme à chaque fois, la réalité de la situation est différente des affirmations péremptoires de quelques donneurs de leçon qui sont prêts à coucher avec tous les tyrans pour préserver l’illusion de leur sécurité.

Mais le monde change, le monde bouge, et notre monde est en train de s’effondrer. Le nier ne nous sauvera pas, et il faut donc bouger à notre tour. Dès lors, est-il pertinent de vouloir sauver un régime qui n’a jamais manqué une occasion de nous frapper et qui est à son tour touché par une onde de choc régionale que rien ne semble pouvoir arrêter, ou ne faut-il pas, à supposer que cela soit encore possible, essayer de peser sur l’avenir ? Il s’agit ici d’aider de possibles vainqueurs à abattre un régime puis à tenir l’inévitable choc qui viendra des jihadistes. Armons l’ASL, essayons de la rendre efficace, et frappons le Jabhat Al Nusra (que les Etats-Unis viennent d’inscrire sur leur liste noire) en poursuivant l’affaiblissement du régime syrien. La stratégie est incroyablement osée, elle n’offre aucune garantie de succès, mais elle a le mérite de rendre les choses plus claires, de faire tomber les masques. Et tant pis pour les tyrans au petit pied, tant pis pour ceux qui pensent qu’un révolutionnaire arabe ne peut être qu’un terroriste, tant pis pour les stratèges d’un autre temps qui entendent sacrifier la liberté des autres pour sauver la leur.
On entend aussi quelques spécialistes, ou reconnus comme tels lors des causeries à la salle des bêtes du village, faire d’habiles comparaisons entre la Syrie et l’Afghanistan des années ’80. Mais au lieu d’étayer leur propos sur la mosaïque communautaire ou les influences étrangères, ils ne sont bons qu’à relayer les clichés les plus éculés sur la CIA et le jihad, une vieille thèse fascinante bien plus subtile que les réflexions de comptoir de quelques vieilles badernes. Ces habiles observateurs ne voient pas, justement, que l’idée d’armer l’ASL est une leçon tirée du conflit afghan des années ’80. Et ceux-là ne voient pas non plus que les Occidentaux essayent désormais de contrer l’influence des Etats du Golfe, alors qu’ils l’ont subie aveuglement il y a trente ans. Et les mêmes, toujours prompts à relayer les idées les plus idiotes et les plus simplistes, d’affirmer que la CIA est à la source de l’islam radical, et du jihadisme. Faut-il conseiller à ces beaux esprits de repenser à l’assassinat du président Sadate, en 1981 ? Ou leur demander de relire le récit du massacre de Hama, en 1982 ? Oui, chers amis, le monde est bien plus complexe que vous ne pourrez jamais le concevoir.
Au 21e siècle, dans notre monde devenu si petit, le malheur des uns fait décidément le malheur des autres. Les cris d’horreur poussés à Damas aujourd’hui résonneront à Paris demain comme ceux poussés à Alger hier résonnaient déjà à Paris. Entre des tyrans en uniforme et des tyrans barbus, il n’y a pas à choisir. C’est à cela que l’on mesure le volontarisme, contre l’immobilisme de Machiavels du pauvre qui se sont trompés d’époque et dont on pourrait espérer, après une vie d’erreurs, qu’ils se retirent en silence.
Quant à moi, qui suis loin de détenir la vérité, je ne vous dis pas que ça marchera, mais mieux vaut agir que geindre.
Le bar est ouvert.