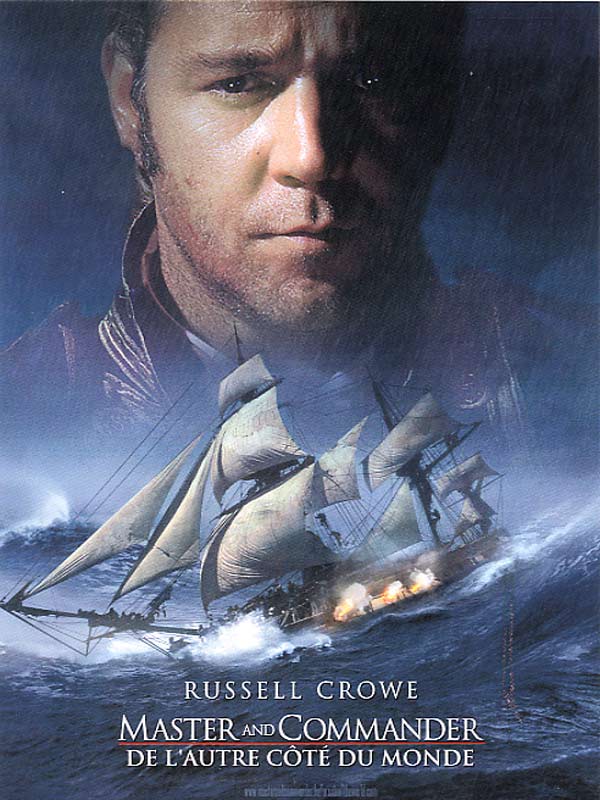Au sortir de la Seconde guerre mondiale, les forces aériennes américaines (US Army Air Forces, US Naval Aviation et USMC Aviation) comptaient dans leurs rangs des centaines d’as (5 victoires et plus) ayant combattu dans le Pacifique, en Afrique du Nord et en Europe. Des pilotes américains avaient volé au sein de la Royal Air Force dès 1940, avant d’être progressivement rassemblés, à partir de février 1941, au sein de trois Eagle Squadrons (No 71, 121 et 133), puis intégrés à la 8th Air Force en 1942, tandis que d’autres, membres de l’ American Volunteer Group (AVG) de Chenault en Birmanie et en Chine du Sud (les Tigres volants), avaient mené la vie dure à la chasse japonaise.
La qualité des appareils (P-38 Lightning, P-47 Thunderbolt ou P-51 Mustang, voire P-39 Airacobra ou P-40 Kittyhawk pour les USAAF, F-4F Wildcat, F-6F Hellcat ou F-4U Corsair pour la Navy ou les Marines) y était évidemment pour quelque chose, de même que la qualité décroissante des pilotes allemands ou japonais. Paradoxalement, soit dit en passant, la supériorité numérique des alliés, qui écrasait progressivement les chasses ennemies, ne favorisait pas l’émergence d’as en raison du relatif manque de cibles par pilote. Pour tous, cependant, les qualités de combattants et de techniciens du vol des pilotes américains ne faisaient pas de doute, et elles furent rapidement élevées au rang de mythe national.
Très vite, l’USAF, créée en septembre 1947, se transforma massivement sur chasseurs à réaction – de l’intérêt de servir une armée riche. Le P-80, renommé F-80 Shooting Star, devint le premier jet de chasse en dotation massive de l’Air Force, avant d’être rapidement épaulé puis remplacé par le F-84 Thunderjet et le F-86 Sabre. De son côté, la Navy mit elle aussi aux rencarts ses chasseurs à piston, comme le remarquable F-8F Bearcat, et se dota de jets, comme le FH-1 Phantom, puis le F-2H Banshee et surtout le F-9F Panther.
Autant le dire tout de suite, cette première génération de chasseurs à réaction en service dans les forces de l’Empire, si elle assurait une supériorité sur le reste du monde (vitesse en palier, vitesse ascensionnelle, accélération, puissance de feu), ne révolutionnait pas vraiment l’art du dog fight, dont les lois fondamentales restèrent inchangées : voler dans le soleil, repérer le premier, surprendre, viser juste et abattre en une sale passe, ne pas s’acharner, etc. L’arme de bord par excellence restait le canon (de 20 mm pour l’Empire), ou, éventuellement la roquette, et le radar embarqué n’en était qu’à ses débuts (faible portée, pas de calculateur, viseur optique simple). Du coup, il fallait savoir manœuvrer, « secouer son zinc » comme l’auraient dit des personnages de BD, et tout cela se passait, naturellement, quasiment à portée de voix.
MiG alley
Le début de la Guerre de Corée, en 1950, permit aux aviateurs de l’Empire de tester au-dessus de la péninsule leurs chasseurs et leurs propres aptitudes contre les pilotes chinois et – chut ! c’est un secret – russes. Le 8 novembre 1950, un pilote de Sabre abattit deux MiG-15 nord-coréens lors de la première rencontre entre jets.
Evidemment, et comme d’habitude, chaque camp revendiqua le plus grand nombre de victoires aériennes. Longtemps, l’Empire vécut d’ailleurs sur le mythe d’un ratio victoires/pertes indécent (15 contre 1 !) et parfaitement irréaliste qu’aucun historien sérieux ne retient plus. Il semble, malgré tout, que les pilotes américains aient bien largement dominé leurs adversaires (kill ratio autour de 7 contre 1, quand même), avec des périodes de crise et de doutes. Les pilotes communistes, pas moins méritants, étaient cependant moins bien formés et moins dirigés. Et quoi qu’on nous veuille nous faire croire dans une certaine littérature et sur quelques forums complaisants, il y eut aussi des as chinois (une petite dizaine), nord-coréens (on parle de 4), et même russes, dans cette affaire.
En mai 1952, la Navy, désireuse de maintenir le niveau général de ses pilotes, créa sur la base des Marines (Marine Corps Air Station – MCAS) à El Centro (Californie) la Fleet Air Gunnery Unit (FAGU) destinée à l’entraînement au combat. En 1958, le FAGU fut déplacée vers la MCAS Yuma (Arizona), tandis que la mode évoluait, de plus en plus, vers les missiles air-air.
Les appareils de la FAGU (ici, F-8U Crusader, F-4D Skyray, A-4D Skyhawk et FJ-4 Fury) furent ainsi, sans doute, les premiers appareils de la Navy spécialement employés lors d’exercices de combat dissemblables (DACT), mais l’expérience ne dura pas tant il devenait évident pour les stratèges et les industriels que l’avenir était au combat à moyenne portée à l’aide de missiles guidés.
Un missile ou rien
L’irruption du missile air-air guidé, par infrarouge ou par radar, révolutionna naturellement le combat. Dès la seconde partie de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands avaient utilisé des missiles air-surface guidés, et avaient envisagé des armes emportées contre les avions ennemis, mais il leur manqua, entre autre chose, du temps. Comme le faisait remarquer mon prof d’Histoire de Terminale au sujet des pays de l’Axe écrasés sous les bombes, « ‘fallait pas y aller ».
Dès 1946, Hughes avait entamé la mise au point pour l’Air Force de l’AIM-4 Falcon (Air Interceptor Missile, désignation post-1962, je vous épargne les dénominations pré-62 et je suivrai dorénavant cette règle), qui entra en service en 1956 et se révéla d’une presque complète inutilité contre des cibles manoeuvrantes, comme le découvrirent rapidement les équipages de Phantom au Vietnam. Le Falcon, d’abord à guidage thermique puis à guidage semi-actif, avait une faible portée, une faible charge militaire et on pouvait assez aisément le faire décrocher…
La Navy, de son côté, avait lancé les travaux en vue de se doter, elle aussi, d’un missile air-air, ce qui donna l’AIM-9 Sidewinder, un authentique succès industriel toujours en service et qui pourrait bien être produit pendant encore des décennies. Le Sidewinder, à guidage infrarouge, se révéla plus rapide, plus agile et plus puissant que le Falcon, mais il restait un missile à courte portée, sorte de prolongement du canon en dog fight. L’obsession de l’interception de bombardiers nucléaires, mission prioritaire en ces temps de guerre froide, requérait l’emploi de missiles à plus grande allonge, et l’AIM-7 Sparrow, dont les origines remontaient un programme de 1947, semblait répondre à ce besoin.
A guidage semi-actif – c’est-à-dire, pour faire simple, doté d’un petit radar le guidant vers une cible elle-même éclairée par le radar de l’avion lanceur, le Sparrow , que l’on vit monté sur le F-7U Cutlass ou sur le F-3H, équipa d’entrée les F-4 Phantom II de la Navy puis ceux de l’Air Force.
L’heure était à la confiance absolue dans la technologie, et les appareils, surtout ceux de l’Air Force, en charge de la défense de l’Amérique du Nord, étaient conçus pour foncer vers les formations de bombardiers soviétiques pour les décimer à l’aide de missiles puissants et rapides, et pour certains dotés de charges nucléaires. C’était l’époque des successeurs du F-89 Scorpion ou du F-94 Starfire, comme le F-102 Delta Dagger et son grand petit frère, le F-106 Delta Dart (et leurs AIM-26 Falcon à tête nucléaire, terrifiante évolution de l’AIM-4 déjà évoqué), sans parler de l’incroyable YF-12, dont le couple radar/missiles finit par équiper le F-14, et qui devint lui-même le SR-71. Mais c’est une autre histoire.
Inutile de dire que personne au sein de l’Air Force n’envisageait sérieusement de commander des chasseurs maniables, et l’effort portait sur les radars, la vitesse des appareils, la rapidité de leur réaction, la qualité des transferts de données entre les stations du réseau de veille du NORAD et la précision des trajectoires d’interception.
La Navy, pour sa part, paraissait loin du débat. Elle n’avait pas participé au programme des Century Series et devait remplir deux missions principales : projeter de la puissance grâce à ses groupes aéronavals et être capable de les défendre contre les bombardiers soviétiques.
C’était le début des groupes embarqués richissimes, équipés de chasseurs, d’avions d’attaque, d’avions de veille, d’avions de lutte anti-sous-marine, puis d’avions de guerre électronique, sans parler des hélicoptères ASM et de sauvetage. Le F-4H Phantom II, héritier du F-3H Demon, qui constituait la dernière évolution des chasseurs embarqués, de plus en plus lourds, avait pour mission de protéger le groupe aéronaval mais les contraintes de l’emploi sur porte-avions limitaient, malgré tout, les dérives (poids et vitesse à l’appontage, manœuvrabilité, robustesse). Le Phantom II se présentait comme un chasseur massif, puissant, conçu pour le combat à moyenne portée grâce à l’emport d’au minimum quatre Sparrows sous le fuselage, voire de quatre Falcon en plus sous les ailes. Personne n’envisageait sérieusement que l’interception puisse se terminer en combat tournoyant, et aucun canon n’était prévu – même si on pouvait, par coquetterie, accrocher un pod de 20 mm en point central.
Étonnamment, le Phantom côtoyait dans les unités de chasse embarquée (VF) le Crusader, un appareil très différent. Ce dernier, bien qu’équipé, lui aussi, d’un radar, emportait en effet quatre canons de 20 mm dans le nez, et jusqu’à quatre Sidewinder sur ses flancs. La communauté des pilotes de F-8 en était persuadée, et elle reprit avec plaisir le slogan du consortium Ling-Temco-Vought (LTV) qui construisait le chasseur, « si vous n’êtes pas dans un F-8, vous n’êtes pas dans un chasseur ».
On peut noter, en passant et sans se moquer parce que ce n’est pas notre genre, que les responsables britanniques allèrent encore plus loin dans la confiance aveugle dans la technologie en annulant à l’époque tous leurs programmes de chasseurs pilotés. Ils estimaient, en effet, que l’avenir était aux avions de combat guidés du sol et que, de plus, les performances des missiles air-air allaient sonner le glas de la chasse traditionnelle. La France, elle, s’obstina et conserva sur les Mirage le fameux canon DEFA de 30 mm qui fit des merveilles – une question de point de vue, évidemment, et les pilotes syriens ou égyptiens étrillés par les Mirage III CJ israéliens ne sont sans doute pas d’accord…
Le rapport Ault
Comme souvent, les réalités opérationnelles rappelèrent cruellement à la réalité aux stratèges et autres responsables. Les premiers engagements aériens au-dessus du Vietnam, en 1965, firent voler en éclats les certitudes.
Face à leurs appareils lourds et paradoxalement trop puissants et trop rapides, les pilotes de l’Air Force et de la Navy trouvèrent des chasseurs infiniment moins sophistiqués, (MiG-17, 19, et 21), maniables, utilisant presque exclusivement leurs canons (23 ou 37 mm…) et pratiquant donc à outrance le combat tournoyant. Les pilotes américains, qui de plus devaient combattre au-dessus du territoire ennemi, étaient confrontés à des conditions climatiques détestables qui dégradaient les performances de leurs missiles. Mais, disons-le franchement, ces derniers n’avaient de toute façon pas besoin de ça pour ne pas marcher. Le Sparrow, en particulier, se révéla particulièrement peu fiable, et il fallait parfois en tirer quatre – soit la dotation habituelle d’un Phantom – pour toucher un MiG…
Les pilotes nord-vietnamiens, qui redoutaient, malgré tout, les missiles et qui n’en possédaient eux-mêmes que très peu, choisirent rapidement de pratiquer le dog fight à outrance, se collant littéralement aux appareils américains. Plusieurs as nord-vietnamiens déclarèrent après la guerre qu’ils avaient décidé de combattre comme on le faisait au-dessus de la France en 1917 : en se mettant dans la queue de la cible et en vidant leurs magasins. Avec un canon de 37 mm, on imagine les résultats. Evidemment, la multiplicité des cibles aériennes offertes par l’Empire favorisa l’émergence de pilotes aux palmarès élevés, vainqueurs d’avions de guerre électronique ou d’attaque, voire de drones, mais il serait injuste de nier les grandes qualités de ces as.
Si l’on considère les seuls combats entre chasseurs, entre 1965 et 1968, le ratio victoires/pertes pour la Navy fut de 2,75/1, et seulement de 2,15/1 pour l’Air Force. De plus, les statisticiens du Pentagone établirent qu’en 1966 seuls 3% des pertes enregistrées étaient dues à la chasse nord-vietnamienne. En 1967, ce pourcentage passa à 8%, et atteignit finalement 22% lors du premier trimestre 1968. Cette même année, le ratio de la Navy atteignit même un très inquiétant 1/1…
Naturellement, il faut lier ces données aux évolutions de la guerre, et en particulier aux offensives aériennes américaines au-dessus du territoire nord-vietnamien, mais il était évident que quelque chose ne fonctionnait pas. Le constat était d’autant plus évident que les unités de F-8 de la Navy enregistraient de bons résultats, comme la VF-211 (8 victoires), dont les membres se surnommaient, en toute modestie, les MiG killers. Ce n’est pas de l’orgueil, c’est de la lucidité.
Au total, les F-8 abattirent au-dessus du Vietnam 19 appareils adverses (16 MiG-17 et 3 MiG-21). Certes, la plupart des victoires furent remportées à l’aide de Sidewinder (4 MiG-17 seulement furent abattus au canon), mais l’emploi de ce missile à courte-portée requérait de mener un véritable combat rapproché, à quelques kilomètres de la cible.
Le taux de réussite des flottilles de F-8 ne changeait cependant rien au constat général. Preuve était faite, dans la douleur, qu’une armée pouvait perdre en une décennie ses compétences les plus précieuses. Et les pilotes de toutes les armes engagées réclamaient des canons de bord. Paradoxalement, le principal chasseur de supériorité arienne de l’Air Force au Vietnam, le Phantom, n’en emportait pas non plus, alors que les F-100 Super Sabre ou les F-105 Thunderchief en étaient équipés. Certains chefs faisaient pourtant preuve d’imagination, comme le légendaire Robin Olds (16 victoires, dont 4 au Vietnam) à la tête du 8th Tactical Fighter Wing (TFW) basé en Thaïlande, qui monta quelques opérations d’anthologie.
Evidemment, cette situation n’avait pas échappé à la haute hiérarchie militaire – comme quoi – et l’amiral Moorer, patron des opérations navales, chargea le capitaine Ault de mener une étude sur le sujet. Le résultat, connu sous le nom de Rapport Ault (téléchargeable ici) établit en 1968 un constat brutal, remettant en cause bien des certitudes et posant autant de questions gênantes.
Le capitaine Ault s’interrogeait ainsi sur la valeur des équipages, la pertinence de leur entraînement, leurs capacités à utiliser toutes les ressources de leurs avions, ainsi que sur la qualité de la doctrine du « tout missile » ou, autre point bien gênant, sur l’adéquation entre les matériels achetés par la Navy et ses besoins réels – sans parler de la qualité des missiles qui avaient tendance à faire long feu ou à se perdre. Dans ses conclusions, Ault disait les choses avec le langage rude des hommes d’action et écrivait, parmi d’autres paragraphes percutants :
Existing schools for CVA guided missile officers and squadron ordnance officers are not adequate. A course is needed designed specifically to provide information on missile theory and operation, test equipment, handling and assembly, publications, and reporting requirements.
Since decommissioning of the Fleet Air Gunnery Unit (FAGU) in 1960 there has been a gradual loss of expertise and continuity in the field of fighter weaponry. This trend must be reversed by providing a means of consolidating, coordinating, and promulgating the doctrine, lore, tactics, and procedures for fighter employment.
Comme un fait exprès, on avait en effet dissous à Yuma, en février 1960, la FAGU, quelques années avant que les pilotes de l’aéronavale ne soient engagés dans de véritables opérations de guerre. Ault suggérait simplement que l’unité soit réactivée, et il proposait qu’elle le soit à partir de la VF-121, le Phantom Replacement Air Group (RAG) stationné en Californie, sur la NAS Miramar.
Il faut dire que les petits gars de la VF-121 et ceux de la VF-124 (le Crusader Replacement Air Group, connu aussi sous le nom de Crusader College) avaient commencé en cachette, dès 1965, à organiser des DACT entre Phantom et Crusader et qu’ils avaient entraîné dans leur projet, comme le raconte Richard Wilcox, leurs camarades de la VA-126, une unité chargée d’entraîner au vol aux instruments les pilotes de Skyhawk. Il n’est ainsi pas anodin de constater que l’impulsion ayant conduit aux agresseurs et autres adversaires vint d’unités d’entraînement avancé.
Et pendant ce temps, à Tonopah…
Evidemment, l’Air Force n’était pas en reste et elle était pleinement engagée, malgré les réticences de certains caciques, dans des travaux visant à améliorer les performances des pilotes et de leurs appareils.
Dès 1953, l’Air Force avait pu se procurer un Yak-23 auprès de la Yougoslavie et l’avait testé à Wright-Patterson – une histoire fascinante racontée, notamment, ici, et qu’évoque Curtis Peebles dans son livre Dark Eagles. Le chasseur russe avait été intensément étudié par une petite équipe de pilotes, et chacun avait pu en conclure que les avions de l’Empire étaient bien supérieurs… La volonté de se procurer d’autres appareils soviétiques ne faiblit pas, la DIA et la CIA essayant plusieurs pistes au fil des ans. Il s’agissait surtout d’évaluer au plus près les progrès technologiques du bloc de l’Est afin d’y répondre.
En 1968, dans le cadre du projet Have Doughnut, un Mig-21 iraquien, dont le pilote avait fui vers Israël en 1966, avait fait l’objet d’évaluations poussées dans une zone particulièrement secrète de Nellis AFB (Nevada), dans le polygone d’essais de Groom Lake, que les geeks et autres conspirationnistes du monde entier connaissent sous le nom de Zone 51 et qui est, en effet, une base secrète. Il en faut, n’en déplaise à certains.
Evalué par la Foreign Technology Division (FTD) de l’Air Force Systems Command (AFSC) au sein de laquelle évoluaient des pilotes de l’ Air Force mais aussi des officiers détachés de l’escadron de test de la Navy, la VX-4, ce MiG-21 – redésigné YF-110 – fut rapidement rejoint par deux MiG-17, également d’origine iraquienne et dissimulés dans les registres en tant que YF-113A et YF-114C… Je conseille à ce sujet la lecture du livre Steve Davies, Red Eagles, qui expose l’ensemble du programme Constant Peg, et je vous renvoie à l’article d’Andreas Parsch au sujet des covert designations des chasseurs de l’Empire.
Une fois maîtrisés par la poignée de pilotes autorisés à les piloter, ces MiG furent confrontés lors de DACT à des équipages d’unités régulières mais triés sur le volet, et l’idée des aggressors se renforça encore. Se renforça, dis-je, car des expériences très poussées avaient été conduites par l’Air Force dès 1965.
Le programme Feather Duster, lancé cette année-là peu de temps après le début des opérations aériennes au Vietnam, visait ainsi à mettre au point les meilleures tactiques de combat au profit des F-4C et autres F-105, les principaux chasseurs de première ligne de l’Air Force. Des unités de l’Air National Guard (New York, Maryland, et Porto Rico) dotées de F-86H furent mises à contribution et participèrent à des séries d’engagements lors de Feather Duster I et II. Le Sabre était censé y jouer le rôle du MiG-17, et il y remporta, certes aux mains de pilotes chevronnés, un grand nombre de combats simulés.
Ces combats ne visaient cependant pas à aguerrir des pilotes mais à déterminer dans quel domaine de vol les chasseurs US étaient les plus vulnérables. La rapport final identifiait ainsi des conditions précises d’emploi en terme, par exemple, d’altitude et de vitesse, qui, si elles n’étaient pas remplies, devaient conduire les équipages à ne pas engager le combat. Une partie de la doctrine d’emploi des chasseurs américains se vit renforcée par ce travail (importance de la puissance moteur, priorité accordée aux missiles, etc.), mais, et ce fut le point le plus désagréable, tous les problèmes identifiés par ce programme se trouvèrent cruellement confirmés dans les cieux vietnamiens.
A nous deux, Baron Rouge !
 Comme je l’écrivais plus haut, le taux de pertes au combat au Vietnam était particulièrement insatisfaisant. L’Air Force, comme la Navy, était évidemment préoccupée par ses piètres performances. Le principe de réalité appliqué au combat aérien faisait grincer bien des dents dans les états-majors, qui avaient tant misé sur les plates-formes de tir et se retrouvaient tenus en échec par des chasseurs bien moins sophistiqués. L’incapacité à tirer des conclusions des exercices Feather Duster faisait jaser. Entre 1967 et 1969, trois études successives nommées Red Baron I, II et III, furent donc menées concernant l’ensemble des combats entre appareils américains et nord-vietnamiens depuis le début des opérations aériennes, en 1965. Il s’agissait, engagement après engagement, de détailler les tactiques ennemies et d’identifier les manques des équipages US. Des centaines de pilotes furent interrogés au cours de ce qu’il faut bien appeler un gigantesque RETEX.
Comme je l’écrivais plus haut, le taux de pertes au combat au Vietnam était particulièrement insatisfaisant. L’Air Force, comme la Navy, était évidemment préoccupée par ses piètres performances. Le principe de réalité appliqué au combat aérien faisait grincer bien des dents dans les états-majors, qui avaient tant misé sur les plates-formes de tir et se retrouvaient tenus en échec par des chasseurs bien moins sophistiqués. L’incapacité à tirer des conclusions des exercices Feather Duster faisait jaser. Entre 1967 et 1969, trois études successives nommées Red Baron I, II et III, furent donc menées concernant l’ensemble des combats entre appareils américains et nord-vietnamiens depuis le début des opérations aériennes, en 1965. Il s’agissait, engagement après engagement, de détailler les tactiques ennemies et d’identifier les manques des équipages US. Des centaines de pilotes furent interrogés au cours de ce qu’il faut bien appeler un gigantesque RETEX.
Ce travail colossal, initialement mené par le 4520th Combat Crew Training Wing (CCTW) qui devint ensuite le Tactical Fighter Weapons Center (TFWC), listait les insuffisances et concluait, sans surprise, à l’impérieuse nécessité de tout revoir et de tout changer, malgré les hurlements des mandarins de la Fighter Weapons School (FWS) qui, pour faire simple, refusaient l’évidence et jouaient les vieilles ganaches. Au sujet de la guerre aérienne au Vietnam, je ne peux que conseiller le classique de Marshall L. Michel III, Clashes.
You two characters are going to Top Gun
Parallèlement aux réflexions conduites par l’ Air Force, la Navy n’avait pas perdu son temps et mit en place ce qui allait devenir Top Gun. Les premiers stages commencèrent en mars 1969 à Miramar, sous l’égide de la VF-121, qui se vit attribuer une poignée d’appareils supplémentaires (A-4 issus des escadrons d’attaque en cours de transformation sur A-7 Corsair II, et T-38 Talon gracieusement prêtés par l’Air Force).
Le cursus (US Navy Postgraduate Course in Fighter Weapons Tactics and Doctrine) des équipages stagiaires consistait en quatre semaines de cours et de dissimilar air combat trainings (DACT) au cours desquels on leur apprenait, dans les conditions les plus réalistes possibles, comment se comporter lors d’un combat rapproché.
Il s’agissait ainsi de réapprendre aux pilotes de l’aéronavale à secouer leurs avions, à ne pas s’en remettre aux seuls missiles et à apprendre à évoluer contre des appareils qu’ils ne connaissaient pas – ou peu. Les études avaient, en effet, démontré que les pilotes américains étaient abattus au-dessus du Nord Vietnam au cours de leurs premières missions (grosso modo : les 10 premières) et que les risques d’être descendus décroissaient rapidement à mesure que leur expérience du combat augmentait. Vu avec le recul, ça semble logique, mais il fallut quand même des études statistiques pour démontrer cette loi. A Top Gun, l’idée était donc, très simplement et très logiquement, de les soumettre à un entraînement si exigeant et si réaliste qu’on pourrait les considérer comme aguerris, quand bien même ils n’auraient jamais connu de véritables combats. Une sorte de déniaisage en Phantom, si je puis me permettre, obéissant aux fortes pensées chères aux fantassins, du genre Entraînement difficile, guerre facile, ou La sueur épargne le sang. Oui, je sais, que de souvenirs.
Depuis 1967, un escadron de perfectionnement, la VA-126 (cf. supra), devenue VF-126, pratiquait déjà à Miramar l’entraînement au combat aérien (Air Combat Maneuvering – ACM) pour les unités embarquées de la Navy. Avec le recul, la VF-126 doit sans doute pouvoir être considérée comme la mère de tous les agresseurs et autres adversaires.
En 1972 fut, enfin, créée la Navy Fighter Weapons School (NFWS), qui obtint rapidement un statut d’escadron indépendant de la VF-126. Il existait désormais sur la base de Miramar deux entités chargées exclusivement d’enseigner le véritable combat aérien aux pilotes de chasse.
Les résultats de ce nouveau programme ne se firent pas attendre, et la tendance au-dessus du Vietnam s’inversa rapidement. Dans la dernière partie de la guerre, le ratio victoires/pertes de la Navy atteignit ainsi 8,33/1, jusqu’à culminer à 12 /1 au printemps 1972. Le 10 mai 1972, au début de l’opération Linebacker II, le binôme Cunningham/Driscoll, de la VF-96, abattit même trois Mig en une seule mission.
Pour beaucoup, le fait que le pilote et son opérateur radar (RIO) aient été diplômés de Top Gun expliquait tout, et c’était sans doute vrai. Pour la petite histoire, Cunningham, qui devint le patron de la VF-126, se lança par la suite dans une carrière politique qui le conduisit à la Chambre des Représentants, où il fut considéré comme un des plus corrompus des hommes politiques de l’histoire américaine. On est bien loin des heures glorieuses du Golfe du Tonkin et de Yankee Station…
A Top Gun, les équipages de Phantom étaient confrontés à des Skyhawk, appareils qu’ils côtoyaient au sein de leur groupe aérien embarqué (CAW), mais aussi à des T-38, rapidement remplacés par des F-5E/F Tiger II. Le Skyhawk était censé simuler le MiG-17, tandis que le T-38 et le F-5 dont il était issu simulaient les MiG-21, plus rapides.
Rapidement (dès 1970, me semble-t-il), les appareils reçurent des camouflages exotiques et des marquages censés imiter ceux des chasseurs du bloc soviétique et de ses alliés. L’aéronavale américaine portait alors une livrée très codifiée grise et blanche, et le contraste fut saisissant. Inutile de rappeler à quel point les militaires sont sensibles à ces marques distinctives, symbole d’une appartenance à un corps d’élite. Les appareils de la Navy, agrémentés d’une étoile rouge sur la dérive, devinrent le symbole et la marque distinctive des adversaires de la Navy.
Viva Las Vegas
Les performances de la chasse embarquée américaine au Vietnam s’améliorèrent donc de façon spectaculaire, à tel point qu’il semble que les pilotes nord-vietnamiens décidèrent de s’en prendre en priorité aux Phantom de l’Air Force et d’éviter ceux de la Navy. On n’est jamais trop prudent… Du coup, les pertes de l’Air Force s’accrurent encore, et son ratio victoires/pertes était plus mauvais en 1972 qu’en 1968.
Les chefs de l’Air Force étaient bien conscients qu’un conflit en Europe serait un défi d’une toute autre ampleur que l’engagement au Vietnam et qu’il fallait d’autant plus s’y préparer que, manifestement, tout le monde n’était pas prêt. En 1972, alors qu’était créée Top Gun à Miramar, il fut donc décidé, enfin, de tirer les conséquences des différents rapports écrits depuis des mois et d’activer à Nellis une nouvelle unité de chasse, le 64th Fighter Weapons Squadron (FWS) doté de T-38 puis, lui aussi, de F-5E/F, qui devint ainsi le premier escadron d’agresseur de l’Air Force. Le 64th FWS rejoignit le 414th Fighter Weapons Squadron, recréé, lui, en 1969 pour remplacer le 4538th Combat Crew Training Squadron et doté de Phantom, et les deux unités furent complétées en 1975 par le 65th FWS tandis que de deux autres escadrons étaient activés outre-mer (cf. infra).
En 1976, le 414th CTS remplaça même le 4440th Tactical Fighter Training Group (TFTG) et le grand cirque fut enfin en place.
Ces unités allaient constituer l’ossature de l’opposite force (OPFOR) de Red Flag, les manoeuvres géantes que l’Air Force mena dans le Nevada à partir de Nellis, dès 1975 et qu’avait longuement suggérées le colonel Suter, un vétéran du Vietnam, convaincu, lui aussi, qu’il fallait aguerrir les pilotes. Ces unités seraient ainsi régulièrement engagées contre des équipages venus participer à ces exercices, censés être très réalistes et reproduire les conditions de vastes batailles aériennes dans un environnement opérationnel impliquant des moyens de guerre électronique, des ravitailleurs, des bombardiers et même des avions de transport, de jour comme de nuit. Les 64th et 65th FWS seraient ainsi plus particulièrement chargés, de façon encore plus poussée que ce que leur homologue de Miramar, la VF-126, réalisait, de reproduire les méthodes de combat de la chasse soviétique.
Dans le désert commencèrent donc de grands travaux visant à reproduire tout ce qu’un pilote de l’Air Force aurait à frapper quand le moment serait venu : bases aériennes, concentrations de blindés, sites industriels. Ce furent sans doute des moments bénis pour tous ces grands enfants qui purent essaimer dans le désert du Nevada quantités d’épaves (avions, blindés de toute sorte) sorties des dépôts.
Dix ans après le début du fiasco de la guerre aérienne au Vietnam, les principales composantes aériennes des forces américaines s’étaient donc dotées de deux centres d’entraînement avancé. A Miramar, l’aéronavale avait mis en place une école de chasse qui organisait des stages intensifs permettant aux équipages des VF de se mesurer à des instructeurs particulièrement capés volant comme des pilotes soviétiques. A Nellis, l’Air Force était allée encore plus loin en transformant radicalement son Warfare Center et en proposant, non seulement des exercices de combat aérien, mais aussi des manoeuvres complètes associant dog fights, frappes tactiques et guerre électronique.
Ce fut le début d’un véritable âge d’or, qui dura jusqu’au début des années 90, lorsque les dividendes de la paix entraînèrent de drastiques réductions d’effectifs.
Arbitrage vidéo
Pour bien tirer les leçons de ces combats, encore fallait-il dépasser l’exploitation des images des ciné-mitrailleuses et ne pas se fier aux cris de victoire des pilotes. En plus d’éviter les bagarres dans les vestiaires, les instructeurs désiraient disposer d’outils leur permettant de reconstituer les trajectoires et manoeuvres de chacun, et de gérer le grande nombre d’appareils engagés dans les exercices.
Les chasseurs furent donc équipés sur un rail lance-missile d’un pod ACMI (ACM Instrumentation) transmettant en temps réel à une salle de contrôle l’ensemble des données du vol. Associé à un AIM-9 inerte emporté pour sa tête chercheuse, ce pod recueillait des éléments qui, associés à ceux des autres participants, contribueraient à des débriefings poussés.
L’importance des exercices menés depuis Nellis conduisit, tout naturellement, à la mise au point d’un mécanisme de suivi des appareils et de restitution des performances, connu sous le nom de Nellis Air Combat Training System (NACTS).
Rien de pire que les tricheurs.
La gloire de l’Empire
Navy et Air Force, chacune à leur façon, commencèrent à répandre dans leurs rangs ces nouvelles méthodes d’entraînement. On créa des unités, on acheta du matériel, on modifia les cursus et on systématisa les manoeuvres avec les agresseurs et les adversaires.
La plus rationnelle fut certainement l’ Air Force. Les exercices Red Flag, qui débutèrent en 1975, furent déclinés sous l’impulsion des Pacific Air Forces (PACAF) en 1976, en un exercice organisé en Alaksa sous le nom de Cope Thunder.
Deux escadrons, affectés aux PACAF et à l’ US Air Force in Europe (USAFE), furent chargés de répandre la bonne parole auprès des unités de ces deux grands commandements régionaux.
A Clark AB, aux Philippines, le 26th Tactical Fighter Training Squadron (TFTS), créé en 1973 mais seulement actif à partir de 1976 avec une poignée de T-38 puis des F-5E, se chargea d’entraîner les unités stationnées en Corée du Sud et au Japon.
A RAF Alconbury, au Royaume-Uni, le 527th Tactical Fighter Training Aggressor Squadron (TFTAS), fut créé en 1975 et activé en 1976 avec des F-5E, devenu décidément le plastron standard.
Les choses étaient donc claires. Pour rencontrer des agresseurs, il fallait aller à Nellis, Clark ou Alconbury. Les escadrons, après quelques hésitations, furent tous progressivement rebaptisés Tactical Fighter Training Aggressor Squadron et devinrent des affectations particulièrement recherchées. Pour le détail de l’histoire de ces escadrons, je vous invite par ailleurs à consulter le site de l’Air Force Historical Research Agency, une véritable mine d’or.
Du côté de l’aéronavale, disons-le tout de suite, ce fut légèrement différent. Je dois confesser ici ne pas avoir réussi à répondre à toutes les questions. Les livres de Rick Llinares ou George Hall sont avant tout de superbes recueils de photos et d’anecdotes, et le livre de Richard Wilcox ne répond pas à toutes les questions. Et même le site du Naval History and Heritage Command ne parvient pas à lever plusieurs ambiguïtés en ce qui concerne l’histoire de certains escadrons.
De même, et bien que certaines de ses pages soient incohérentes ou incomplètes, le site de l’A-4 Skyhawk Association regorge d’informations et de témoignages précieux. On peut également consulter Home of the MATS, le site de référence sur le F-14, voire interroger les membres de la Navy Adversary Pilot Association.
Bref, poursuivons. L’aéronavale possédait, elle aussi, un centre nerveux pour son programme de DACT, et il s’agissait, naturellement, de Miramar où étaient stationnées la NFWS et la VF-126. Une autre unité, la VA-127, initialement moins en pointe que la VF-126, fut rapidement impliquée. Basée à NAS Lemoore, la VA-127 devint la seconde adversary unit de la côte Ouest en 1975, en recevant des A-4 et, surtout, des TA-4J.
Sur la côte Est, un premier escadron stationné à NAS Oceana, la VF-43, fut activé dès 1973. Constitué à partir de la VA-43, cette nouvelle unité, elle aussi dotée de Skyhawk et de F-5, reçut également des T-2 Buckeye, un appareil d’entraînement plutôt pataud mais pas dénué de charme qu’utilisait en petit nombre la VF-126. Mais les T-2 de la VF-43 étaient camouflés, et ça change tout…
Surtout, la VF-43 fut la seule unité de la Navy à recevoir une douzaine de Kfir loués à Israël de 1985 à 1988 et utilisés par l’Empire sous le nom de F-21 Lion.
La VF-43 fut rapidement rejointe par la VF-45 – encore un escadron de Skyhawk devenu une unité d’adversaires. Rapidement stationnée à NAS Key West, la VF-45 fut la 4e unité d’active, en plus de la NFWS elle-même, à être chargée des DACT.
Le moral de l’aéronavale, requinqué par les achats de matériels décidé par l’Administration Reagan, grimpa encore grâce aux performances, très médiatisées, du F-14, qui devint une star des médias dans le cadre d’une campagne de propagande particulièrement bien montée. Déjà, en 1980 (donc sous l’Administration Carter), Don Taylor, un tâcheron de Hollywood avait tourné The Final Countdown, avec Kirk Douglas et Martin Sheen (quand même !).
Et comme Don Taylor n’était pas du genre à laisser de côté les copains, il tourna pour la télévision, en 1981, Red Flag: The Ultimate Game, avec William Devane et Joan Van Ark, tout droit sortis de Côte Ouest. Oui, je sais.
Pendant que les citoyens de l’Empire découvraient à quel point la Navy était puissante, celle-ci donnait une petite leçon de savoir-vivre à deux pilotes libyens. Le 19 août 1981, au-dessus du Golfe de Syrte, deux F-14 de la VF-41 expédièrent au tapis en 45 secondes deux Su-22 Fitter J de la glorieuse Jamahiriya. Anytime, baby.
Juste pour le plaisir, rappelons que la VF-32 détruisit à son tour deux chasseurs libyens, deux MiG-23 Flogger, le 4 janvier 1989. Trois ans après le triomphe mondial du film de Tony Scott, Top Gun, il y avait de quoi bomber le torse.
Jusqu’au début des années 90, l’aéronavale développa tous azimuts ses unités d’adversaires. En plus du parc aérien de Top Gun et de ceux des 4 escadrons de première ligne, (VF-43, VF-45, VF-126 et VFA-127) déjà mentionnés, la Navy associa à l’ensemble un certain nombre d’unités de soutien (Composite Squadron, VC), des unités de la Naval Reserve, et, fort logiquement, les RAG qui affectaient les équipages tout juste sortis d’école. Certaines unités de formation de base, comme la VT-7 de la NAS Meridian, ne résistèrent pas à la tentation et se permirent de rompre avec la livrée des appareils d’entraînement de l’aéronavale à l’occasion des cours d’Air Combat Maneuvering. Mais les tâches de couleur ne font pas les agresseurs (proverbe californien).
Au temps de sa toute puissance, la Navy disposait par ailleurs d’une quantité appréciable d’unités de soutien stationnées aux quatre coins de l’empire, sur les deux côtes, dans les Caraïbes, à Hawaï et jusque dans les Philippines. Ces escadrons de réservistes, tous dotés de l’increvable Scooter – le surnom du Skyhawk – remorquaient des cibles, véhiculaient en place arrière des autorités, prêtaient leurs appareils aux officiers ayant besoin de se décrasser ou de remplir leur carnet de vol, et ils s’initièrent avec empressement au DACT. Certains, comme la VC-2, se livraient déjà à l’exercice depuis des années, un peu comme M. Jourdain.
Et comme la demande croissait et croissait encore, la Navy fit également appel à des escadrons de chasse de la Naval Reserve, les VF-201, 203 et 204. Je dois d’ailleurs avouer ici mon ignorance. Tandis que l’Air Force concentrait à Nellis l’essentiel de ses sessions de formation et d’entraînement, l’aéronavale multipliait, pour sa part, les unités impliquées, manifestement en soutien de Top Gun. S’agissait-il d’essaimer des escadrons d’adversaires au profit des groupes aéronavals en croisière afin de procéder à des entraînements permanents ? N’y a-t-il pas eu une mode du DACT, chaque responsable de base, chaque commandant de Wing désirant sa petite bande d’adversaires ? Cette politique a-t-elle permis de considérablement relever le niveau des réservistes ? Je n’ai pas trouvé de réponse satisfaisante, du moins à ce stade de mes recherches.
En route pour Fallon
Au Liban, l’état-major de la marine, qui voyait ses efforts en matière de combat aérien récompensés, découvrit que les escadrons d’attaque n’étaient plus capable d’affronter un environnement raisonnablement hostile. Le 4 décembre 1983, lors d’un raid contre des positions syriennes, trois appareils (un A-6E TRAM et deux A-7E) furent perdus, un pilote tué, et un autre capturé. Après les années d’efforts pour relever le niveau de la chasse, découvrir que les unités d’attaques avaient également des lacunes à combler fut sans doute un sale coup.
Il fut rapidement décidé de remettre tout le monde au travail puisque, pendant que tout ce petit monde s’envoyait en l’air au large des Keys ou au-dessus de la Sierra Nevada, les escadrons d’attaque de la Navy avaient manifestement perdu l’expérience acquise au Vietnam. Dès mai 1984 fut installé à NAS Fallon (Nevada) le Naval Strike Warfare Center (NSWC), sorte d’équivalent pour l’aéronavale de ce qui existait à Nellis depuis près de dix ans.
Surnommé Strike U, ce nouveau centre venait compléter les écoles existantes basées à Mirama, la Navy Fighter Weapons School – Top Gun, et la Early Warning Weapons School – Top Dome. Il s’agissait là aussi de réapprendre à combattre, mais dans le domaine des frappes aériennes et des missions d’appui. Le raid du Beyrouth avait été, plus qu’un fiasco, un signal inquiétant pour une Navy censée pouvoir participer à des opérations de guerre dans un contexte autrement plus sérieux.
En 1987, la VF-127, devenue VFA-127 (Strike Fighter Squadron) fut transférée à Fallon et entama ses missions d’adversaire contre les escadrons d’attaque de la flotte qui se transformaient depuis des années sur F/A-18 Hornet.
(Les puristes que vous êtes n’auront pas manqué de noter que ces F-5 portent des insignes de dérive libyens et nord-coréens, tandis que ce F/A-18 arbore une marque irakienne. Ah, les enfants…).
Electronic adversaries
Cet intérêt accru pour l’art délicat du raid aérien et pour la simulation poussée conduisit à une autre innovation, permise par l’importance des budgets de ces années bénies. Dès 1977, la VAQ-33 de Key West avait participé à des exercices de guerre électronique, mais la recréation de la VAQ-34, en 1983, marqua le vrai début des agresseurs électroniques. Les deux unités, dotées de versions spécialisées des appareils en service dans l’aéronavale (EA-6A Prowler, EF-4J Phantom II, EA-4F Skyhawk, EA-7L Corsair II, ERA-3B et EKA-3B Skywarrior et même un EC-121K Warning Star), participèrent à des exercices de grande ampleur. La VAQ-34 permit même à des équipages féminins de piloter des Skyhawk et des Corsair.
En 1991, la VAQ-35, dotée d’EA-6B, fut à son tour activée et les trois escadrons se trouvèrent alors sous le contrôle du Fleet Electronic Warfare Support Group (FESWG).
La communauté des Adversaires de l’aéronavale était alors au sommet de sa puissance. A Miramar et Fallon, deux écoles fournissaient un entraînement de qualité. Sur les côtes Est et Ouest comme dans des bases outre-mer, des unités de soutien et de réserve participaient à ce gigantesque effort de remise à niveau et alimentaient la gestation du mythe. Mais la paix était là et l’heure fut à la réduction, rapide, des budgets de la défense.
Fin de la récréation
Les différents programmes d’agresseurs et d’adversaires étaient évidemment critiqués. Leurs détracteurs y voyaient un Barnum que se réservait une élite pour jouer à la guerre avec des avions qui auraient été bien plus utiles dans des unités de première ligne. La Navy, par exemple, avait obtenu de commander, à la fin des années 80, des F-16 pour remplacer ses F-5 et A-4. 22 F-16N et 4 TF-16N (des F-16C et D modifiés) avaient ainsi été achetés, et des F-21 (cf. supra) avaient été loués à Israël. Tout cela commençait à faire désordre, d’autant plus que les missiles marchaient enfin, que l’empire soviétique était en train de s’effondrer et que les pilotes du Tiers-Monde n’étaient, disons le mot, que des amateurs.
Le programme de DACT de l’aéronavale était un véritable gouffre financier, une danseuse qui faisait voler des dizaines d’avions dans des escadrons éparpillés sans véritable cohérence de doctrine ou de tactique. Même les Marines s’y étaient mis en créant, en 1986 sur la MCAS Yuma, un escadron d’adversaires, la VMFT-401, d’abord dotée de F-21 – elle-aussi – puis, à partir de 1989, de F-5E.
Les Marines, qui ne sont pas les derniers pour la rigolade, avaient même affecté un escadron de soutien, le H&MS-31, à des missions de DACT dès 1965, mais il ne s’agissait là que d’un pis-aller, loin du professionnalisme des unités dédiées au programme. Mais tout le monde avait son petit groupe d’adversaires sous la main, ça faisait chic.
L’ Air Force, en transformant Red Flag en véritable académie occidentale du combat aérien, pensait avoir été bien plus habile. Comment envisager, en effet, de supprimer les plus grandes manoeuvres de l’OTAN, à la fois creuset d’une véritable interopérabilité et vitrine de la puissance impériale ? Ce subtil calcul n’allait pourtant pas sauver les escadrons de Nellis.
Pour les uns et les autres, malgré les succès, le réveil allait donc être brutal.
Quand ça change, ça change
Il faut dire que pendant ces vingt années de DACT intensifs à Nellis et Miramar, le contexte avait bien changé. La chute de l’URSS, l’indépendance de ses satellites, l’isolement croissant de leurs anciens alliés au Sud, tout avait concouru à assoir l’écrasante domination aérienne occidentale. Les chasseurs de l’Empire étaient polyvalents, maniables, puissants, et fiables. Ils avaient été testés par les Israéliens pendant les années 80, et tout le monde avait été rassuré. Au moins 86 victoires contre la chasse syrienne en 1982… ça cause, quand même.
Le nouveau missile AIM-120 était satisfaisant, et les nouvelles versions du Sidewinder fonctionnaient à merveille. Les chasseurs entrés en service depuis les années 70 ont tous été conçus en fonction des leçons tirées du conflit vietnamien, qui ont par ailleurs au développement des unités d’adversaires et d’agresseurs.
Tous dotés d’un canon, tous capables d’engager des combats rapprochés, ces chasseurs ne sont pas seulement de bonnes plate-formes de tir. Evidemment, le F-14 était sous-motorisé, oui, le F/A-18 n’a pas un rayon d’action très satisfaisant, mais le F-16 est un appareil très agile et le F-15, bien que massif, est un adversaire redoutable. Cette génération d’avions de combat était performante, et elle allait même être un succès commercial.
En face, les Soviétiques, qui continuaient d’aligner MiG-21, MiG-23 et Su-22, avaient fait entrer en service le MiG-29 Fulcrum et le Su-27 Flanker. Si le MiG-29, équivalent du F-16 ou du F/A-18, s’était révélé décevant, le Flanker fut d’entrée un chasseur exceptionnel, mais, au début des années 90, bien peu d’exemplaires étaient en service. J’en profite pour indiquer ici que les Soviétiques déployèrent eux aussi des escadrons d’agresseurs, dotés de MiG-23 et de MiG-29, en particulier sur la base de Mary, au Turkménistan. Bref, ne nous égarons pas – et ne parlons pas des F-5 sud-vietnamiens transférés en URSS après 1975 ou des F-14 amicalement prêtés par l’Iran.
L’état de délabrement des forces armées soviétiques, la certitude que les dividendes de la paix étaient à portée de main, et le besoin de réduire l’abyssal déficit budgétaire contribuèrent donc à des dissolutions d’unités.
La VC-1 et la VC-5 furent dissoutes dès 1992, suivies par la VC-10 en 1993. Les trois VAQ d’entraînement disparurent la même année, et en 1994 la VF-43 et la VF-126, primary adversary squadrons, furent emportées à leur tour. La VF-74, détachée de l’USS Saratoga, fut brièvement chargée de cette mission de plastron en 1993 et 1994, avant d’être dissoute.
L’Air Force avait été encore plus rapide. A Nellis, le 65th Aggressor Squadron fut dissous dès 1989, et le 64th AS en 1990, ses avions étant transférés au 4440th TFTG. En Europe, le 527th d’Alconbury disparut en 1989, et le 26th AS, basé aux Philippines, le suivit en 1990. En moins de deux ans, l’Air Force élimina donc ses 4 escadrons d’agresseurs, et le flambeau fut finalement confié au 414th Combat Training Squadron en 1991, intégré au 57th Wing et acteur historique de l’aventure.
Mais au moins le matériel évoluait-il et les F-16 (C et D) remplacèrent en 1989 les F-5 (E et F). Il leur revenait la mission de simuler le MiG-29 et le Mirage 2000, les stratèges de l’Empire redoutant à l’époque leur prolifération dans les pays hostiles.
Et alors tous partirent dans le désert
Les réductions d’effectifs ne touchaient pas que les unités de danseuses, et un effort de rationalisation avait été entamé sous l’impulsion de la Defense Base Closure and Realignment Commission (BRAC). En 1993, il fut donc décidé de déplacer vers la NAS Fallon Top Gun et Top Dome, et d’attribuer Miramar aux Marines. La fin de Fightertown…
Ce mouvement administratif se concrétisa de façon spectaculaire en 1996, avec la création du Naval Strike and Air Warfare Center (NSAWC) à Fallon.
Cette nouvelle école rassemblait donc, fort logiquement d’ailleurs, Top Gun, Strike U et Top Dome au sein d’un vaste complexe associant l’aéronavale et les Marines.
Sans atteindre la taille et l’importance de Nellis, cette nouvelle entité était tout sauf un caprice ou une installation de seconde zone. Mais la réduction de format de la communauté des adversaires se poursuivit et la VFA-127, dernière unité d’active, fut dissoute à son tour en 1996. Elle fut remplacée à Fallon par la VFC-13, un escadron de réserviste en provenance de Miramar (cf. tableau supra Naval Reserve Adversary Squadrons) qui, après avoir brièvement volé sur F/A-18, était désormais équipé de F-5E et F puis de F-5N – des F-5 suisses présentant des différences mineures mais au potentiel plus important rachetés à la Confédération helvétique en 2006.
En 1996, plus de vingt ans après le début de Top Gun et l’institutionnalisation du concept d’adversaires, l’aéronavale de l’Empire ne disposait plus que de deux escadrons spécialisés et de la composante aérienne du NSAWC…
Renaissance
L’effort militaire entrepris par les Etats-Unis depuis le début des années 2000 mit fin à cette période de vaches maigres. La persistance des tensions avec la Corée du Nord et l’Iran, l’évidence de la compétition avec la Chine et la Russie, la montée en puissance de l’Inde, tout contribuait à un renforcement des capacités d’entraînement des forces aériennes.
Dès 2003, le 64th AS fut réactivé à Nellis et doté d’une vingtaine de F-16C et D block 32, le 414th CTS devenant alors une unité de soutien entièrement dédiée à la tenue des exercices Red Flag. Les F-16 reprenaient ainsi leur rôle de faux MiG-29.
Fin 2005, ce fut au tour du 65th AS de renaître, équipé de F-15C aux livrées également chatoyantes.
Le dispositif fut enfin complété en 2006 par la transformation en Aggressor Squadron du 18th Fighter Squadron stationné à Eielson AFB, afin de donner une ossature aux manoeuvres Red Flag Alaska qui venaient d’être créées.
L’Air Force avait reconstitué en trois ans un ensemble d’unités spécialisées visant à maintenir le niveau de ses pilotes. Mais, alors que près de 40 ans plus tôt les insuffisances constatées au Vietnam avaient conduit à la mise en place d’un programme structuré, la décision de donner une nouvelle dynamique et de nouveaux moyens à la communauté des agresseurs reposait d’abord sur des constats géopolitiques et techniques. L’heure n’est plus aux « enroulages à blanc » avec les chasseurs libyens ou russes en Méditerranée, et la supériorité des pilotes de l’Empire est théorique.
Les unités Red Flag évoluent, plus que jamais, en fonction des renseignements fournis par la DIA et des observations effectuées à Nellis ou lors de manoeuvres outre-mer. Dans ce domaine comme bien d’autres, on ne connait pas la valeur réelle de ses combattants tant qu’ils n’ont pas été confrontés au feu ennemi. Si le F-16 et le F-15 sont de bons appareils, fiables (mais âgés, s’agissant des F-15C), le F-22 constitue d’ores et déjà une déception dans le domaine du combat tournoyant. Plate-forme de tir furtive, le Raptor s’est révélé plutôt lourd lors de ses premiers DACT et un article d’ABC News en juin dernier révélait qu’il avait été sérieusement secoué par des Typhoon II allemands lors d’un Red Flag – Alaska. Le 23 juillet 2012, David Cenciotti, sur son blog The Aviationist, notait d’ailleurs, l’air de rien, que les pilotes de la Luftwaffe ne semblaient pas peu fiers de leurs performances.
Censé nettoyer le ciel à distance de sécurité, le F-22 pourrait ainsi bien n’être que la version la plus aboutie du chasseur dont rêvaient les concepteurs du YF-12 ou du F-14… Et le F-35, pour prometteur qu’il soit malgré les inévitables difficultés de mise au point, ne semble pas être non plus conçu pour le dog fight. Il reste donc le F-16 et le F-15E pour faire le travail, pour l’instant.
Top Gun revival
La même année, la VFC-13 de Fallon détacha à NAS Key West un groupe de F-5 qui devint, après quelques mois, la VFC-111 – en reprenant les traditions d’un mythique escadron de chasse, la VF-111.
De son côté, à Oceana, la VFC-12 tenait, vaille que vaille, son rôle d’adversaire à un rythme plus que soutenu. Considérée comme l’unité la plus demandée de toute l’aéronavale, elle est encore un escadron de réserve à la solide réputation d’excellence.
Enfin, à Fallon, les instructeurs volaient sur des F/A-18 de différents types et, depuis 2003, sur des F-16 pakistanais bloqués par un embargo et destockés de l’Aerospace Maintenance and Regeneration Center (AMARC) de David-Monthan AFB. Le Pakistan peut donc être utile à quelque chose.
Au-delà de la propagande relayée par des auteurs le plus souvent fascinés et facilement influencés par le mythe en échange d’un vol plein de frissons, il faut, en effet, estimer que ces trois escadrons et la composante chasse du NSAWC représentent la fine fleur de l’aéronavale. Pour autant, la dimension dog fight est menacée par les qualités mêmes des appareil acquis par l’aéronavale depuis plus de vingt ans, pas aussi maniables que les F-16 de l’Air Force. Le Hornet et son successeur, le Super Hornet, n’ont ainsi pas l’agilité du Viper et rien n’indique qu’il seront capables de tenir face à des Mirage 2000 ou des Su-27 bien pilotés. Cela dit, la doctrine impériale prévoit justement que le ciel soit dégagé grâce à l’action combinée des appareils de guerre électronique, des plate-formes de tir et des avions de C4I. Mais, comme l’écrivait Tom Clancy, un plan de bataille est obsolète après le premier coup de canon.
(voix martiale) Vers l’infini, et au delà
40 ans après les premiers balbutiements des adversaires et des agresseurs, le concept est donc largement validé. De nombreuses armées de l’air ont d’ailleurs créé des unités spécialisées ou réaffecté des escadrons existants.
Le Canada voisin a son propre exercice, Maple Flag, lui aussi ouvert aux alliés de l’Empire, et l’étoile rouge des agresseurs fait fantasmer tous les pilotes occidentaux.
Les besoins sont tels que des sociétés privées proposent désormais leurs services. Vous n’avez pas les moyens d’affecter trop de vos chasseurs à des unités de danseuses ? Pensez au privé !
On croise désormais sur les tarmacs des Alpha Jet ex-Luftwaffe, des A-4L ex-RNZAF ou des Kfir ex-Heyl Ha’Avir…
Mais l’avenir n’est pas là. Alors que la Navy et les Marines gèrent sereinement à Fallon un dispositif fidèle aux origines du programme, l’Air Force innove. Le concept d’agresseur, s’il n’était que l’amélioration de pratiques anciennes, a donné naissance à une véritable culture de l’entraînement agressif, tourné vers la découverte des failles, l’identification des faiblesses et la validation de contre-mesures. A Nellis oeuvrent des milliers de spécialistes au sein du gigantesque complexe décrit, notamment, par Bryan Jones sur son Jonesblog.
Dans le sillage de Red Flag, des unités d’agresseurs spécialisés ont ainsi été créées afin de brouiller les GPS, les flux de données transitant par satellite ou les communications via Internet. La priorité donnée par les Etats-Unis à ce que certains appellent la cyber war – alors que la Chine fait preuve d’une fascinante audace dans le domaine – laisse présager le développement de cette nouvelle dimension. Je ne vais cependant pas m’aventurer sur cette voie, moi qui sais à peine utiliser mon Mac, et plutôt penser avec nostalgie au bon Scooter de la Navy s’agitant au-dessus des hauts plateaux californiens…
Un grand nombre des illustrations de ce post viennent de l’incontournable site Airliners, qui regorge de photos parfois exceptionnelles mais aussi de renseignements, pour qui veut chercher, ainsi que de sites officiels.