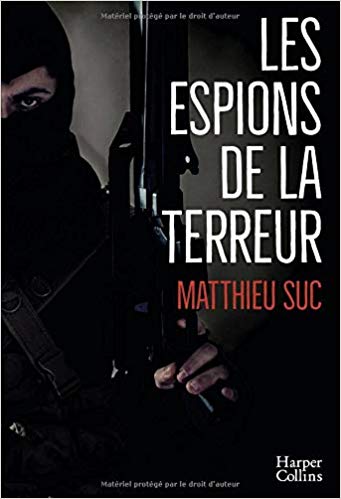Personnalité intrigante à défaut d’être attachante, John Milius a exercé sur Hollywood et la pop culture une influence majeure, jusqu’à inspirer aux frères Coen l’inoubliable Walter Sobchak en 1998.
Coscénariste d’Apocalypse Now (1979), de Magnum Force (1973), de Jeremiah Johnson (1972), de Danger immédiat (1994) ou de Rome (2005-2007), Milius n’a cessé de diffuser au sein du cinéma américain ses obsessions et ses certitudes politiques. Grand amateur d’armes à feu, farouche défenseur d’une certaine identité américaine faite d’individualisme, d’esprit pionnier et d’acceptation des guerres nécessaires, il a réalisé une poignée de films marquants, dont l’indépassable Conan le Barbare (1982, d’après l’univers de Robert E. Howard) ou L’Adieu au roi (1989, d’après le roman Pierre Schoendoerffer). On lui doit aussi, en 1984, Red Dawn, une étrange dystopie dans laquelle se mêlent cinéma de guerre, teenage movie, et même quelques réflexions – parfois involontairement et tragiquement ironiques – au sujet de la liberté, de la résistance, de la violence dans un monde imprévisible et injuste, et même de la morale.
Série B d’honnête facture, L’Aube rouge se veut le récit des faits d’armes d’une poignée d’adolescents d’une petite ville du Colorado après l’invasion des États-Unis par les Soviétiques, dans la première partie des années ’80. Le film décrit par le menu l’irruption dans une communauté en paix d’envahisseurs venus conquérir et occuper, et fait preuve d’une étonnante sobriété alors que l’on pouvait raisonnablement s’attendre au pire de la part de Milius, le genre de type débonnaire qui se promène en gilet tactique, flingue en pogne, dans les studios. En France, il serait sans doute devenu blogueur défense.
L’ensemble, naturellement, souffre de nombreux défauts, à commencer par l’invraisemblance de la situation de départ et les moyens limités de la production. La transformation d’hélicoptères français SA.330 Puma en Mi-24 Hind autorise cependant des scènes qui, à l’aune des productions du début des années ’80, paraissent plutôt honorables, et l’important, de toute façon, est ailleurs. Le film n’a aucune vocation documentaire (et certainement pas l’ambition d’être réaliste) et son propos est plus complexe qu’il n’y paraît. Tout le contraire, on le voit, de récentes superproductions nationales.
La distribution, qui s’appuie évidemment sur des jeunes premiers, permet à de futures têtes d’affiche de débuter à l’écran. On trouve là Patrick Swayze (et Jennifer Grey, avec laquelle il dansera dans Dirty Dancing (1987), une des plus épouvantables bouses de la décennie), Charlie Sheen (le fils de Martin, le capitaine Willard d’Apocalypse Now, futur golden boy déchu dans Wall Street), Lea Thompson (un an avant Retour vers le futur), et les gueules, reconnaissables entre mille, de Harry Dean Stanton, William Smith, Powers Boothe ou de Lane Smith, échappé de V (1983-1985) et décidément habitué aux personnages ambigus.
En filmant des adolescents et de jeunes adultes combattant une armée d’envahisseurs, Milius, qui ne se perd pas en critiques, fondées mais inutiles, de l’Union soviétique ou du communisme, fait se combattre de jeunes patriotes, sincères et inexpérimentés, et des professionnels de la guerre. L’opposition entre le personnage joué par William Smith, authentique contre-guérillero, froid et méthodique, et celui de Ron O’Neal (Super Fly en 1972, Frank, chasseur de fauves en 1982 et 1983), sincère combattant des luttes émancipatrices du Tiers-Monde, de plus en plus déçu du combat qu’il mène, ajoute à l’envahisseur soviétique une profondeur que peu de films d’action des années ’80 seront capables de générer.
Loin d’être un chef d’œuvre, le film est rapidement devenu culte en raison de ses honnêtes qualités de mise en scène et du parti-pris de son cinéaste, sobre et direct. A la différence de nombreux récits de guerre procédant à de longues installations du décor et des personnages (à la manière des films catastrophe), L’Aube rouge commence abruptement et évite, dans une certaine mesure, les idioties opérationnelles. Tourné sans pathos excessif, il s’agit d’un film étrange qui choisit de montrer une situation locale, un simple épisode isolé d’une guerre mondiale entre deux superpuissances. Milius y fait un clin d’œil appuyé à La Bataille d’Alger (1966), le monument de Pontecorvo, mais il évite, comme le cinéaste italien sut le faire en son temps, de trop appuyer son propos politique.
Son propos est plus minéral, typique d’une certaine idéologie américaine : il faut savoir se battre pour défendre des acquis qui ne sont jamais garantis, il faut savoir survivre loin du confort de la civilisation urbaine occidentale, la violence (exercée ou subie) révèle les âmes et façonne les vies, le monde n’est pas un endroit sûr, etc. Sans fausse honte, le cinéaste place ses héros dans les pas de guerriers arapahos, envahis, conquis et vaincus il y a un siècle par les envahis d’aujourd’hui. La terre ne change pas et est le témoin impassible, presqu’immuable, des guerres et de l’Histoire, nous dit Milius. Ceux qui croient la posséder seront un jour balayés par d’autres conquérants, pas plus éternels que ceux qu’ils auront chassés.
Le film s’inscrit également dans la tradition américaine du cataclysme intérieur, peut-être né (il faudrait interroger des historiens ou des spécialistes du cinéma ou de la littérature US) du traumatisme de la Guerre de Sécession. Depuis des décennies, les États-Unis ne cessent ainsi de produire des récits de leur propre chute : dystopies, destruction porn, zombies, invasions extra-terrestres plus ou moins subtiles, nouvelle guerre civile, et le genre n’est jamais autant vivace que dans les moments de tensions politiques ou stratégiques.
Alors que la Seconde Guerre froide était bien entamée, L’Aube rouge permit d’exalter l’esprit de résistance d’une jeunesse que les adultes n’ont jamais cessé, dans toutes les sociétés, de juger inconséquente et sans ossature idéologique. C’est ainsi à un cinéaste ouvertement réactionnaire, mais capable de citer Pontecorvo ou Melville, que l’on doit un hommage aux adolescents – certes tous blancs – capables de prendre les armes et de se sacrifier pour défendre un pays arraché de haute lutte à ses indigènes, devenus des modèles après avoir été des adversaires impitoyablement massacrés. Ce n’est pas le moindre des paradoxes d’une œuvre étrange, d’une naïveté et d’une brutalité assumées, qui a, finalement, plutôt bien vieilli.