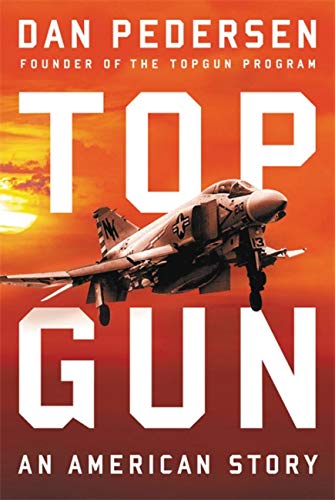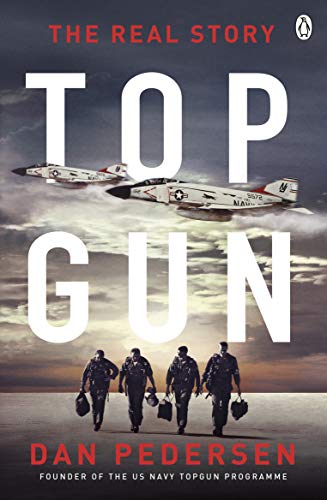Avant d’être une franchise de blockbusters spectaculaires aux scenarii indigents, Top Gun fut la réponse de l’aéronavale américaine aux importantes difficultés qu’elle rencontrait au-dessus du Vietnam contre les MiG. Le rapport Ault, publié en 1968 (il est consultable ici), détailla ce constat douloureux et proposa la création d’une structure d’apprentissage au sein de laquelle les pilotes de chasse, soumis à des entraînements d’un extrême réalisme, seraient en mesure d’acquérir avant leurs premières missions de combat l’expérience qui découle justement de ces moments fondateurs et fait la différence ensuite.
Daniel A. Pedersen était à l’époque pilote de la Navy depuis 1957. Il avait commencé sa carrière sur F4D-1 Skyray au sein de la VF(AW)-3, avait ensuite volé sur F3H-2 Demon au sein de la VF-213 puis était passé sur F-4B Phantom II à la VF-92, ce qui le conduisit à Yankee Station, au large du Vietnam. C’est au retour de cette croisière qu’affecté alors à la VF-121, une importante flottille basée à Miramar, près de San Diego, il fut désigné fin 1968 pour bâtir, à partir de rien ou presque, un cycle de cours et d’entraînements qui allait devenir l’United States Navy Fighter Weapons School et devenir une référence mondiale – et pas seulement au cinéma.
Dans son livre, Top Gun. A American History (2019, Hachette), Dan Pedersen fait le récit d’une carrière d’une incroyable richesse, toute entière tournée vers le combat aérien et, dans un style vif et direct, décrit les réalités de la chasse embarquée américaine des années 50 et 60. On apprend ainsi qu’en 1959 des pilotes de toutes les armes venaient « s’enrouler » clandestinement au sud de l’île de San Clemente, au large de la Californie, afin d’entretenir l’esprit et les techniques du combat tournoyant. Affrontant des appareils d’un autre type que le sien, Pedersen y acquit la certitude que tout entraînement, si on le voulait utile, devait associer des chasseurs différents. Il appliqua cette idée à Top Gun et théorisa le dissimilar air combat training (DACT).

Comme tout projet réellement innovant, la mise en place de cette nouvelle école ne se fit pas sans difficulté. Avec 8 autres pilotes de la VF-121 et un officier-renseignement, (« 9 original bros »), sans moyen propre et confronté à l’hostilité des cadres de Miramar, Pedersen fut chargé de mettre sur pied « en 60 jours » un syllabus digne de ce nom. Observé depuis Washington par les plus autorités de la Marine, le projet fut soutenu avec prudence et tout le poids des efforts pesa sur les épaules de ces 10 officiers. Le dénuement initial de l’école était tel que son premier local fut un préfabriqué abandonné dans l’enceinte de Miramar et dont le déplacement fut payé à un entrepreneur local avec une caisse de whisky. Quant aux avions, il fallut utiliser ceux de la VF-121, ceux des stagiaires et une poignée de TA-4J Skyhawk de la VF-126 voisine.

D’un exceptionnel intérêt, ce livre de souvenirs, dans lequel on croise les MiG volés du programme Constant Peg et où on évoque le tournage de Top Gun, n’est pas seulement le récit, parfois très émouvant, d’une vie remarquable. Il s’agit aussi d’une série de leçons essentielles pour qui prétend former, entraîner et maintenir en condition opérationnelle des professionnels qui, en raison de leurs missions, ont charge d’âmes :
1/ On n’enseigne bien que ce qu’on connaît bien (voire très bien). Une pratique maîtrisée et réfléchit est indispensable (« dont on ne peut se passer ») à la transmission dans de bonnes conditions. Non seulement il faut être expérimenté pour comprendre le sens profond de ce que l’on fait, mais cette expérience est essentielle afin de contribuer à établir la crédibilité de l’instructeur aux yeux de ses élèves ;
2/ A cette connaissance réelle doivent s’ajouter des compétences pédagogiques, et surtout du charisme, sans lesquelles l’enseignement dispensé devient en quelques instants une interminable purge (que celles et ceux qui n’ont jamais somnolé dans un amphithéâtre de l’École militaire – ou ailleurs, dans des enceintes plus discrètes – se signalent à l’admiration de tous). Penser que ses seules compétences pédagogiques suffisent à transformer n’importe quel enseignant en un véritable instructeur est cependant une grave erreur. Votre instructeur a été, il n’y a peut-être pas si longtemps, à votre place, que ce soit à bord d’un F-4B au-dessus du Golfe du Tonkin ou de la campagne nord-vietnamienne comme Pedersen ou derrière des écrans à essayer de donner du sens aux renseignements que recueillent pour vous les capteurs de votre service. Il a connu le doute, les questions, les défis et il a su dominer des situations complexes. Le spécialiste de la pédagogie pourra sans doute vous aider à mieux transmettre vos connaissances, mais il ne pourra en aucune façon parler à votre place. Et s’il le faisait (ou si un esprit malade lui demandait de le faire), la catastrophe serait assurée ;
3/ Être instructeur ne doit pas être une rente de situation. Déconnecté des réalités intrinsèquement mouvantes du terrain (LE TERRAIN… oui, on sait merci), il risque d’être aussi has-been que Madame Carrère d’Encausse et de raconter, au mieux des trucs terriblement datés, au pire des foutaises (comme l’académicienne précédemment citée) qui, non seulement auront fait perdre leur temps aux stagiaires mais auront miné l’intégralité du cursus ;
4/ C’est aussi qu’être instructeur est un honneur, une affectation glorieuse qui vous rend en grande partie responsable du futur comportement en opération de vos jeunes collègues. Donner des cours se prépare, c’est un métier et une mission dont il faut être digne, et l’école où vous allez enseigner n’est pas une maison de repos pour vétéran brisé. Si tout a été fait correctement, vous n’avez pas été choisi par hasard, au détour d’une conversation de chefs débordés, mais bien sélectionné en tenant compte de vos réalisations, de votre goût pour la transmission et de l’importance que vous accordez à cette tâche ;
5/ Enfin, être instructeur vous donne l’opportunité de réfléchir à votre métier, à vos pratiques et ce que vous pourriez changer. Il ne s’agit pas d’une pause dans votre carrière mais de l’opportunité de faire un pas de côté (il faut savoir le faire) afin de vraiment réfléchir. Le centre de formation où vous allez exercer n’est pas hors-du-temps et il devrait être, pour peu qu’on ose lui en donner le mandat et les moyens, le générateur de nouvelles idées, et pas seulement en matière de pédagogie. La triade praticien-enseignant-chercheur devrait être encouragée afin de défier son organisation et l’empêcher de sombrer dans la routine. Là où on enseigne on devrait aussi réfléchir et produire une pensée audacieuse, tant il est vrai qu’on ne franchit utilement les limites que si on les connaît parfaitement. Pour le dire autrement, nous devrions tous être formés par les meilleurs membres de nos équipes dans ce qui ne saurait être que des centres d’excellence.