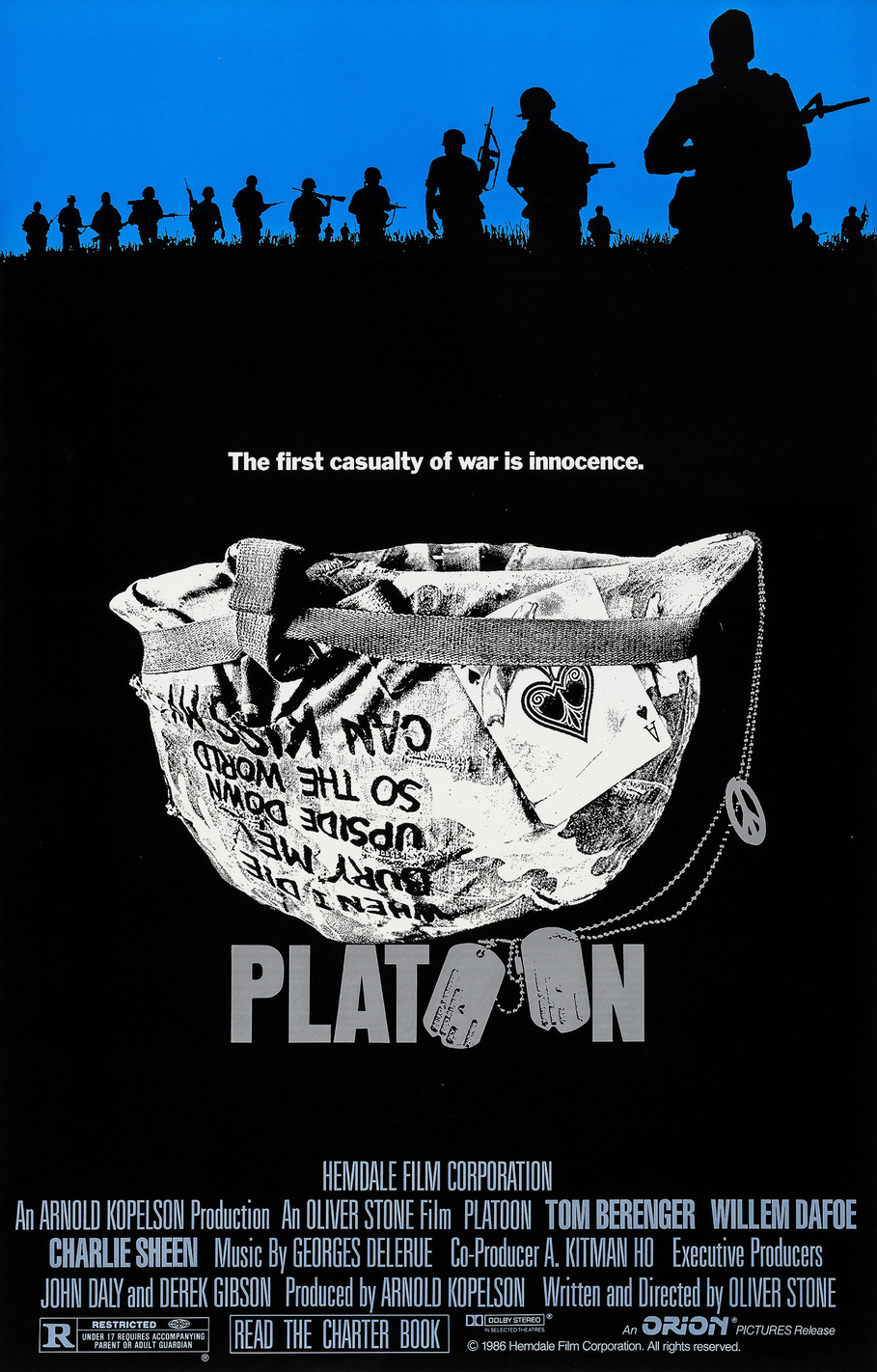La question est aussi vieille que le terrorisme, mais elle ne se pose que lorsque la violence de ceux qui attaquent l’Etat semble insensible aux actions du binôme police/justice. Dans les démocraties, la gestion de ces agressions est parfois confiée à des services de police spécialisés, et c’est évidemment le cas en France.
La réponse idéale à ces attaques ne devrait jamais, en effet, exister en dehors du cadre de la loi, parfois très large si on pense à nos pratiques, mais l’idéal n’est pas de ce monde. La tentation d’employer des moyens plus violents, clandestins, illégaux, naît parfois lorsqu’il semble qu’aucune réponse durable ne puisse être conçue puis mise en œuvre contre certains acteurs violents. Le débat est alors vif, entre ceux qui pensent qu’il ne faut pas transiger avec les principes (ils ont raison) et ceux qui pensent que les principes, non seulement ne sauvent pas de vies et, surtout, peuvent sortir terriblement fragilisés d’une crise politico-sécuritaire majeure (ils n’ont pas tort non plus). C’est dans ces moments qu’on juge ses dirigeants, lorsque le pragmatisme de la réponse est le mélange, le moins imparfait possible, des nécessités sécuritaires et du respect des fameux principes de la République.
La menace jihadiste parmi ses nombreux aspects fascinants, constitue à cet égard un des défis les plus sérieux à notre organisation sécuritaire, comme je ne cesse de l’écrire sur ce blog depuis des années (notamment ici, en 2010, et là, en 2012 – et je vais d’ailleurs vous épargner de nouvelles réflexions sur le sujet). Depuis une vingtaine d’années, tout a été essayé ou presque en matière d’actions répressives, et même préventives, et les actions violentes, plus ou moins clandestines, ont fait partie des réponses de la République.
En 1995, un service cher à mon cœur fit ainsi clairement comprendre aux idéologues londoniens du Groupe Islamique Armé (GIA) – et aussi d’Al Qaïda – qu’il serait judicieux de leur part de cesser la diffusion des communiqués victorieux saluant les attentats commis en France. Et personne ne les menaçait d’un lit en portefeuille, pour ceux qui s’interrogeraient. La même année, Khaled Kelkal fut sèchement éliminé par des gendarmes à la suite d’une chasse à l’homme plutôt virile, et bien naïfs sont ceux qui croient encore que sa mort ne fut pas un message de fermeté envoyé au GIA. La République, comme l’Empire, contre-attaque quand on l’attaque, et il ne serait pas inutile que certains essayent de se documenter avant de lancer des avis définitifs au sujet de la boussole morale que serait la France. Mon cher et vieux pays, oui, mille fois oui, mais pour la boussole morale, va falloir repasser, car la carte de nos alliances dans le Golfe et de nos principaux clients dit tout de la réalité de notre exigence dans le domaine.
Depuis 1995, donc, face au jihad, la France – et ce quels que soient ses dirigeants – a fait le choix de la fermeté. Sur le territoire national, la justice, même imparfaite, a continué d’être saisie. J’ai déjà dit ce que je pensais de la récente loi sur le renseignement, des postulats sur lesquels elle reposait, et de ceux qui les avaient inspirés. Le fait est, malgré tout, que nous sommes encore un Etat de droit et que ça marche à peu près (Attention : je n’ai pas dit que c’était d’une efficacité absolue), au moins pour l’instant.
La fermeté de nos dirigeants – à ne pas confondre avec une réelle stratégie, une authentique vision ou même une réflexion complexe – a conduit à des actions parfois autrement plus viriles hors du territoire national. La doctrine, à supposer qu’il y en ait une quelque part, peut être résumée ainsi : en France, en Europe, en Amérique du Nord, partout où l’action judiciaire peut obtenir des résultats grâce à la coopération entre Etats de droit, la priorité est donnée à la légalité. Si un individu est soupçonné de vouloir commettre, soutenir ou commanditer un attentat, les renseignements recueillis légalement par les services compétents convaincront sans difficulté majeure la justice du pays partenaire que des arrestations doivent être réalisées.
Si cet individu est présent dans un Etat moins sourcilleux quant au respect du droit ou des libertés individuelles, il y aura moyen de s’entendre, et personne n’en saura rien. Là, soyons clair, la boussole morale de la France aura salement perdu le nord, quelque part entre la cave d’une villa isolée et une prison secrète, mais on pourra toujours espérer que la sécurité y aura gagné ce que la noblesse de la cause y aura perdu. Ça aussi, ça fait des années sinon des décennies que ça arrive, et certains commentateurs facilement émus feraient bien de retenir leurs imprécations et leurs larmes car elles sont très très en retard. Personne ne dit que c’est bien, mais c’est ça, aussi, la défense de l’Etat. Et non, je ne me prends pas pour le colonel Jessup.
S’agissant du jihad, il est apparu clairement, avant même le début des années 2000, que la justice ne suffisait pas à enrayer un phénomène qu’une poignée de visiteurs du soir de nos ministres persistent à qualifier de criminel, voire de psychiatrique. Dès lors, que faire ? Dans la mesure du possible, les Etats de droit ont choisi de renforcer leurs moyens intérieurs et, après 2001 (quelle surprise !) d’exercer une pression diplomatique accrue sur certains acteurs de la vie internationale. Face à certaines situations très particulières, que nous connaissons tous, l’option militaire s’est (très) rapidement imposée. Il ne s’est plus agi, alors, d’anti terrorisme mais de contre-guérilla (le terrorisme n’étant qu’un mode opératoire, faut-il le rappeler), et l’action des forces armées a répondu à une menace qui avait pris une telle ampleur que le code pénal et la commission rogatoire internationale étaient devenus sans pertinence.
Très égoïstement, nous sommes quelques uns à avoir pensé que les interventions militaires occidentales, ici ou là, contre des groupes jihadistes avaient au moins le mérite, à défaut d’être victorieuses, de montrer du jihadisme sa vraie nature : celle d’un phénomène complexe, global, capable de défier des Etats, de bouleverser des équilibres régionaux et de menacer des populations. Mais les crises générées ou phagocytées par les groupes jihadistes n’autorisent pas nécessairement des interventions militaires massives, ou n’offrent pas toujours la possibilité de conduire des actions diplomatiques fermes. Comment intervenir dans les zones tribales pakistanaises ? Comment peser sur Riyad ou Islamabad afin qu’ils pèsent à leur tour sur les islamistes radicaux avec lesquels ils ont ou ont pu avoir des relations ? Mystère.
Entre l’action judiciaire, les pressions diplomatiques et les interventions militaires, toutes publiques, existe une zone grise dans laquelle agissent les services spécialisés. A eux reviennent les missions de conseils et d’analyse, mais aussi de préparation à l’action, voire de réalisation d’opérations secrètes. La différence est de taille : il ne s’agit plus d’envoyer des milliers d’hommes affronter des groupes hybrides, dont la plupart des membres sont anonymes et seront combattus comme n’importe quel adversaire sur un champ de bataille, mais bien d’éliminer, par tous les moyens nécessaires, des individus identifiés, chefs militaires, logisticiens, artificiers, financiers, planificateurs. On peut le faire dans une grande ville moyen-orientale avec un grand raffinement opérationnel, et on peut le faire avec un missile de croisière ou une bombe lâchée par un Rafale, un F-15 ou un Predator (mais si c’est un Predator, c’est maaaaaaaal).
La logique n’est plus, alors, de reprendre le contrôle d’un territoire ou même de dégrader les capacités militaires d’une organisation identifiée – ce que fait l’opération Inherent Resolve depuis le mois d’août 2014 contre l’EI – mais d’empêcher un groupe terroriste de passer à l’action. C’est, par exemple, toute la logique des frappes américaines de drones ou de chasseurs bombardiers au Yémen, en Somalie ou au Pakistan. Cette logique pourrait même être assimilée à une opération de police mondiale contre des individus relevant du droit pénal, mais la nature du jihadisme fait que, justement, les actions de police traditionnelles ne sont plus assez efficaces pour se suffire à elles-mêmes et faire que l’Etat remplisse ses devoirs à l’égard de ses administrés. Pour faire simple, si on peut arrêter un suspect, on le fait. Mais s’il le faut flinguer pour obtenir un répit, on le fait aussi. Il ne s’agit pas de s’en réjouir, mais il serait sans doute malvenu de s’en émouvoir aujourd’hui en Syrie alors que nous le faisons au Sahel depuis des années et que nous l’avons fait faire par d’autres (Américains, Britanniques, et j’en passe) dans d’autres endroits. Le choix de tuer des adversaires le plus loin possible du territoire qu’ils veulent frapper est d’une grande logique, et bien que cela n’apporte aucune réponse politique au jihad qu’ils mènent, c’est toujours ça de pris. Je n’ai, à cet égard, pas le début d’un état d’âme, et j’ai même écrit en 2005 une note qui préconisait exactement ça. Ceux que ça amuse et qui ont un vrai métier pourront même la retrouver dans les archives.
A dire vrai, le problème posé par notre intervention en Syrie est ailleurs. Que nous y allions pour y combattre l’EI aux côtés de nos alliés, rien à dire. Que nous y allions pour peser politiquement, à la française, c’est-à-dire sans moyens mais la bouche pleine de belles formules, rien à dire. Que des Français meurent dans des frappes militaires contre des cibles attaquées parce qu’elles étaient importantes pour l’ennemi, rien à dire. Il ne fallait pas être là, les gars. On préviendra vos familles en disant que nous sommes désolés et que c’est ballot. Mais que nous fassions savoir, à l’occasion de confidences gourmandes, que nous visons des Français pour les empêcher de nuire, non non non. Notez bien, mais vous l’avez compris, que la mort d’une poignée de traîtres ne saurait m’enlever le sommeil. Qu’en revanche des opérations habituellement tenues secrètes, pour d’évidentes raisons, deviennent des outils de valorisation politique est absolument lamentable.
Eliminer secrètement et illégalement des adversaires est un ultime recours pour un Etat, plus encore pour une démocratie. Le faire est, sans le moindre doute, un acte hors-la-loi décidé par des responsables politiques et exécuté par des entités spécialisées, civiles ou militaires. Que les éliminations (assassinats ?) pratiquées par les Etats-Unis aient été tactiquement utiles et stratégiquement désastreuses ne se discute plus guère. Que nous soyons contraints, selon les mêmes cheminements, de faire la même chose n’est pas non plus une surprise.
A la différence, cependant, des Etats-Unis, où les actions de ce type sont à la fois rarement reconnues et totalement assumées dans le cadre d’une guerre longue et indécise, les responsables français brillent par l’incohérence, au moins apparente, de leurs positions. Révélées par un conseiller de notre décidément très martial Premier ministre, puis démenties par le ministre de la Défense contre toute évidence, les frappes françaises contre des jihadistes français en Syrie sont d’une rare logique, (cf. ici). On sait qui, au sein de l’EI, planifie des attentats sur notre sol, et puisque c’est paraît-il le seul moyen on élimine l’origine de la menace. Ce faisant, cependant, on ne participe pas vraiment à Inherent Resolve, on fait du contre-terrorisme à des fins uniquement nationales, et le reconnaître est alors une erreur.
Le révéler à la presse démontre que ces actions n’ont pas tant des objectifs opérationnels que politiques. Comme le déploiement de milliers de soldats dans les rues de nos villes, les quelques raids que nos pilotes effectuent dans un environnement pour le moins hostile ne sont que de l’affichage, une forme raffinée de gesticulation qui nous surexpose sans nous garantir une sécurité accrue. Cela révèle également que les autorités restent focalisées sur la menace émanant du seul Etat islamique, comme si les attentats du mois de janvier dernier n’avaient pas amplement et tragiquement démontré qu’il était décidément bien imprudent de sous-estimer les réseaux historiques du jihad – et comme si ces éliminations n’allaient pas avoir des conséquences intérieures et contribuer, on peut le craindre, à déclencher des passages à l’acte. Dans « guerre secrète », il y a « guerre » et « secrète ». La combinaison des deux termes semble difficile à envisager pour des responsables politiques qui n’envisagent de victoire qu’électorale. La défense de l’Etat ne devrait jamais être l’occasion de se pousser du col, mais tout le monde n’est pas Cincinnatus.