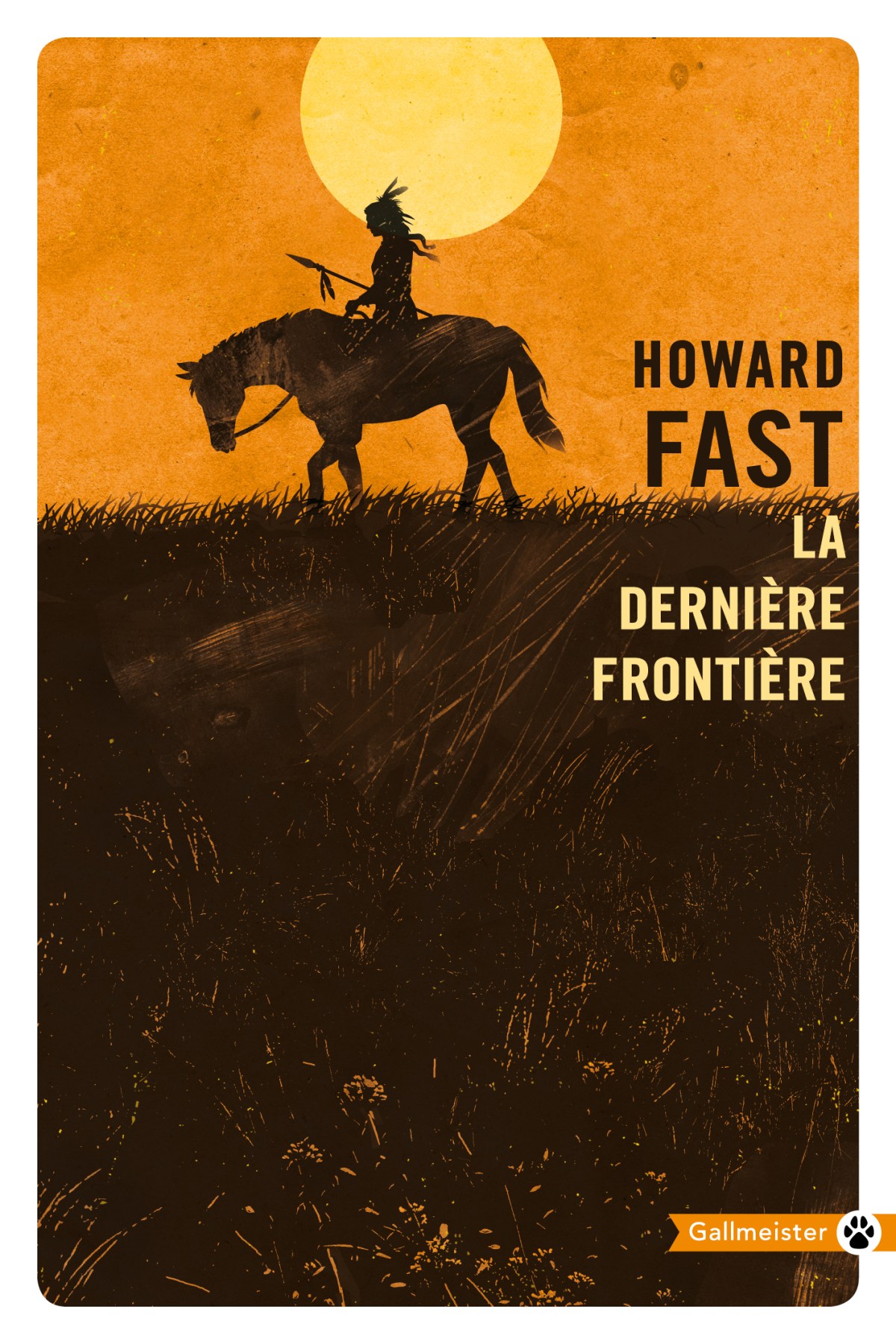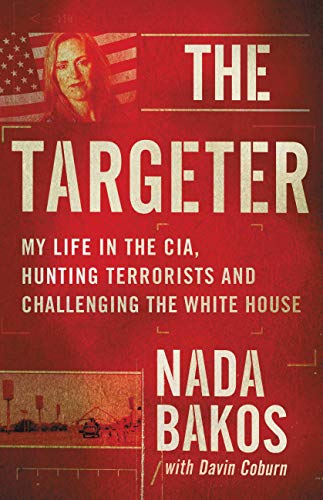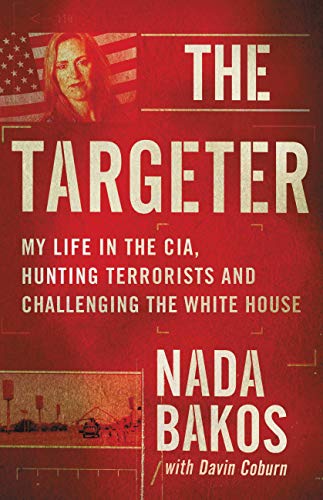Libérer les otages, aussi bien dans un souci humanitaire que pour atténuer autant que possible les conséquences politiques de l’attentat ? Négocier coûte que coûte ou, au contraire, dézinguer tout le monde afin de rappeler la toute-puissance de l’État et la détermination de ses dirigeants ? Les pratiques et les doctrines – quand elles existent – diffèrent aussi bien en raison de la nature des régimes que de leur histoire ou de la menace à laquelle ils sont confrontés.
Les décisions, quoi qu’il en soit, ne sont jamais faciles à prendre. Il faut être correctement conseillé, si possible par des cadres expérimentés et des services ayant réfléchi ; il faut avoir les nerfs solides ; il faut être capable de peser les coûts et les avantages, les risques d’échec et les chances de succès ; il faut éventuellement écouter des avis extérieurs, mais il faut aussi pouvoir se décider rapidement et s’adapter aux évolutions d’une situation qui n’est pas, par nature, sous contrôle. A Beslan, par exemple, des parents fous d’inquiétude franchirent le cordon, très imparfait, établis par les forces russes pour tenter de libérer leurs enfants eux-mêmes, ce qui eut de graves conséquences sur la tragédie en cours.
Le décideur a surtout le besoin impératif d’être accompagné par des forces d’intervention d’autant plus capables d’agir qu’elles ont étudié l’adversaire, ses motivations, ses capacités et ses méthodes – tout étant lié – et qu’elles en tiré des conclusions opérationnelles afin de pouvoir proposer des options. Décortiquer l’adversaire n’est jamais une perte de temps, surtout quand il est quasiment certain qu’il frappera par surprise, et la force la mieux équipée sera sans réelle pertinence si elle ne sait pas qui elle combat.
L’enchaînement de crises, depuis 2012 et surtout depuis 2015, a conduit nos autorités à inclure la fonction essentielle du RETEX dans le plan d’action contre le terrorisme rendu public il y a un an, comme il me semble l’avoir déjà souligné. Cette indispensable évolution ne va cependant pas de soi et elle sera de toute façon longue à se concrétiser. Les habitudes, surtout dans les corps aux solides traditions, ont la vie dure et il faut parfois près de dix ans pour aboutir aux changements escomptés. Aux réticences habituelles, inévitables dès qu’il s’agit de changement, vont en effet s’ajouter les craintes de certains d’être mis en accusation, voire d’être confrontés à leur bilan réel. La démarche gouvernementale n’est pourtant pas de cet ordre et répond avant tout à un besoin essentiel, que les militaires ou les pompiers connaissent bien : être prêt requiert des efforts de chaque instant, et il faut partir du principe que l’ennemi, surtout quand il est irrégulier, a toujours un temps d’avance.
Il faudra ensuite trancher – c’est sans nul doute déjà fait, mais je n’en sais rien – au sujet des méthodes d’intervention choisies. Deux philosophies s’étaient en effet opposées au mois de novembre 2015 (entrer et encaisser le choc en acceptant d’être surpris par un adversaire pas encore totalement localisé et évalué, ou attendre que la situation soit stabilisée et bien documentée afin de concevoir une action adaptée). Ce choix n’est pas que tactique puisqu’il pèse inévitablement sur la durée de l’attentat et sur la planification des autorités. Il implique aussi d’être décliné dans les domaines, ô combien fondamentaux, de l’équipement et de l’entraînement. Une intervention réussie dépend de nombreux facteurs, complexes et entremêlés, mais au premier rang desquels on trouve le courage des opérateurs. Le 13 novembre 2015, un commissaire de la BAC et son chauffeur ont ainsi montré que le cinéma le plus spectaculaire n’est pas toujours si loin de la réalité. Qu’une gloire éternelle les accompagne.
A toute épreuve, de John Woo (1992)
(Aucun chien n’a été tué ou blessé lors de l’écriture de ce billet)