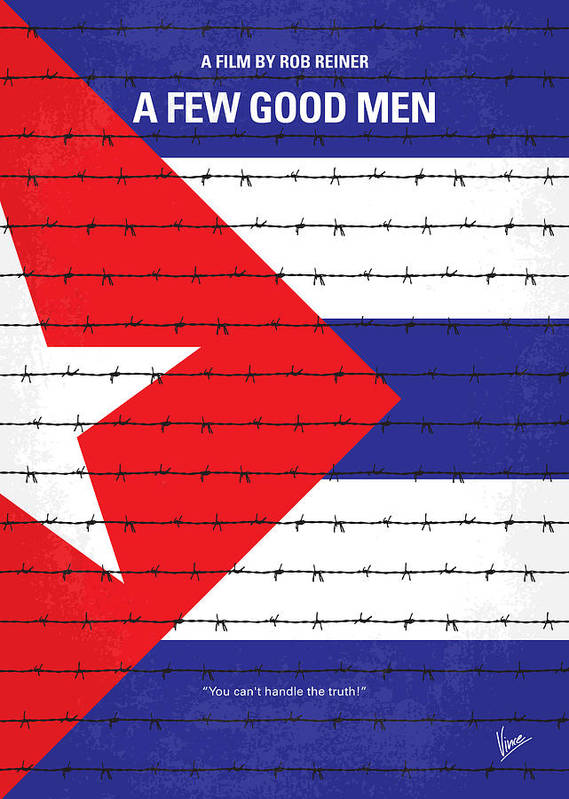Mohamed Merah est mort, enterré, et on dirait que tout est fini. Comme s’il ne s’était agi que d’une aimable mésaventure, que l’on racontera dans quelques années à nos petits enfants. Pourtant, on a compté 7 morts, des soldats, des enfants, abattus de sang froid par un jeune homme que des psychiatres d’opérette et des experts de salon ont tenté de nous présenter comme un dingue isolé, irresponsable. Certains – que leur nom soit à jamais maudit – ont même essayé de le présenter comme une victime, jusqu’à son père – un homme pour lequel j’éprouve décidément bien peu de sympathie, même si sa peine est sans doute sincère. Et les mots me manquent pour qualifier son avocate, la troublante Mme Mokhtari, aux motivations probablement aussi douteuses que ses qualifications professionnelles.

Et puis il y a eu les élections, la vie d’une démocratie blasée, avec ses ridicules disputes, ses pitoyables polémiques, ses bisbilles et, malgré tout, l’expression de la volonté populaire. Et du coup, plus rien. Oublié, Merah. Oublié, le fait qu’une opération terroriste a bel et bien eu lieu en France, dans deux belles villes de province. Oublié, le fait que malgré l’historique excellence de nos services un jihadiste a pu agir et frapper sur notre sol, malgré le renforcement, maintes fois vanté, de nos capacités sécuritaires et de – trop – nombreuses réformes du monde du renseignement. Oublié, le fait que l’action a été revendiquée par un groupe terroriste, le Jund Al Khilafa, d’abord de façon peu convaincante, puis de façon bien plus troublante – et on ne saluera d’ailleurs jamais assez le remarquable travail d’Aaron Zelin sur son blog, Jihadology.
A proprement parler, je n’ai pas enquêté. Je n’ai pas posé de questions, pas appelé d’amis, pas pris des airs de conspirateur en sillonnant Paris. La vie a continué, et, au détour de conversations tenues au restaurant, le sujet est venu sur la table, et à chaque fois, je me suis vu conforté dans mes doutes par le fait que, dans toutes les administrations pudiquement qualifiées de spécialisées, on en était venu aux mêmes conclusions que votre serviteur.
Essayons donc de procéder avec méthode. Je vais vous épargner de longs développements techniques, car il serait aussi inutile de dévoiler ici quelques secrets professionnels que cruel de vous les asséner sans autre explication, et je vais donc me concentrer sur l’essentiel.
1. Fiasco
L’affaire Merah est un fiasco, un gigantesque fiasco, et presque tout ce qui pouvait rater a raté. J’avais initialement, ici, envisagé le fait que Merah avait été simplement, si j’ose dire, meilleur que nos services. Ces choses-là arrivent, et demandez donc aux pilotes de l’Armée de l’Air, pendant le printemps 1940, s’il n’est pas possible de perdre alors qu’on s’est mieux battu. Dans mon esprit, Mohamed Merah, jeune homme intelligent, convaincu de la justesse de son combat, avait réussi à donner le change aux services chargés de le surveiller. Mais on dirait bien, vu d’ici, en tout cas, que la vérité est plus cruelle. On peut gagner parce qu’on est meilleur que l’adversaire, qui est bon. Mais on peut aussi gagner parce qu’on est meilleur que l’adversaire, qui est mauvais. Et Merah n’a, dirait-on, pas été confronté à trop forte partie.
Fiasco, donc. Ou plutôt, fiascos.
D’abord, un fiasco d’ensemble : un terroriste a réussi à tuer sur notre sol, et personne n’a rien vu venir. Je suis désolé, c’est un peu brutal, mais on va avoir du mal à qualifier ça de succès majeur ou de brillante réussite.
Fiasco, ensuite, de l’opération lancée par le RAID, et loin de moi l’idée de nier le courage ou l’esprit de sacrifice de cette unité. Mais les faits sont têtus, comme le disait l’humaniste russe Vladimir Ilitch Oulianov. Le déroulement du siège de l’appartement de Merah a fait bondir bon nombre de professionnels, et on s’interroge jusque dans certaines unités étrangères sur le niveau réel des forces d’intervention françaises, pourtant jusque là portées au pinacle. Les questions sont nombreuses, rien qu’à la lecture de la presse nationale. Par exemple :
– Pourquoi ne pas avoir attendu le début de la matinée et le départ d’une bonne partie des habitants de l’immeuble pour donner l’assaut au lieu d’essayer en pleine nuit ?
– Comment ne pas avoir envisagé qu’un homme soupçonné d’avoir tué 7 personnes de sang froid, dont 3 enfants, allait sans doute se défendre ? Voire, puisqu’il avait combattu en Afghanistan, qu’il allait être un adversaire décidé ? A ce propos, les extraits du compte-rendu du chef du RAID, publiés par Le Point, confirment que les policiers n’avaient aucunement envisagé une telle violence de la part de Merah. Une telle candeur laisse pantois, tout comme l’usage d’un négociateur, alors que jamais des jihadistes assiégés ne se sont rendus et que les cas, au contraire, de baroud d’honneur, sont connus, comme à Leganés, en avril 2004, après les attentats de Madrid. D’ailleurs, et pour tout dire, ces turbulents garçons ont la fâcheuse tendance à se faire exploser dès qu’on les contrarie. Ah, les sales gamins.
– Pourquoi ne pas avoir poursuivi l’assaut jusqu’au bout, lors des premières minutes de la fusillade, comme le fit le GIGN en décembre 1994 à Marignane ? Au final, après 30 heures, le RAID a quand même compté 6 blessés dans ses rangs. A ce compte, autant aller tout de suite à l’essentiel, me semble-t-il, au lieu de faire marche ailleurs dès les premiers impacts. Chacun sait à quel point un siège est pénible à réaliser, et il faut, ne serait-ce que pour des raisons médiatiques, ne pas donner l’impression qu’on piétine.
– Est-il exact d’affirmer, comme le fit le Nouvel Obs il y a quelques semaines, que Mohamed Merah est sorti de l’immeuble pendant le siège, pour téléphoner, parce que personne ne disposait d’un plan correct du quartier et du bâtiment et que celui-ci n’était donc pas correctement encerclé ?
– Finalement, la question que tout le monde se pose, parfois pour de mauvaises raisons, est celle-là : le RAID était-il réellement dimensionné (commandement, doctrine, entrainement, moyens, que sais-je ?) pour mener une telle action ?
Etre et avoir été, les gars…
Fiasco, également, du travail de renseignement : comment un individu, connu, identifié, logé, suivi, traité (rpt fort et clair : traité), a-t-il pu autant abuser ceux qui étaient censés le contrôler ? Depuis plusieurs semaines, la presse emploie sans vergogne, pour qualifier au moins un policier de l’antenne toulousaine de la DCRI, le terme de traitant, sans le moindre démenti officiel. Je suis sans doute un peu simple, mais pour moi les mots ont un sens, et ce sens ne peut être ignoré. En l’occurrence, un traitant traite une source, et il faut bien conclure de tout ce qui a été dit et écrit depuis mars dernier que Mohamed Merah n’était pas un inconnu pour les services de police et pour la DCRI. En relation avec des policiers, il était sur écoute jusqu’à la fin de l’année 2011 (Cf. cet article) et était largement identifié, de longue date, comme un sympathisant actif de la mouvance jihadiste. La regrettée Section Etrangers et Minorités de la défunte DCRG n’avait pas manqué de flair, en 2006, en le jugeant dangereux. Et j’en profite pour adresser mes amitiés aux membres de cette unité d’élite qui travaillaient dans l’ombre pendant que d’autres couraient les caméras. Les vrais héros ne sont pas nécessairement ceux qui plastronnent, je me comprends.

Dès le 27 mars, un article du Point posait la question et relevait les maladresses du discours officiel. Surtout, un autre article du 24 avril, évoquant la surprenante distribution de Légions d’Honneur (note à qui veut : j’attends toujours les ONM pour les membres de la cellule de crise du 11 septembre, si ça vous dit de corriger une injustice) aux policiers impliqués dans l’affaire, revient sur les relations entre un bienheureux brigadier de Toulouse et le jeune terroriste. Sinon, ça va les gars ? Vous pensez à quoi, en vous rasant, le matin ?

Mohamed Merah n’était sans doute pas une source vue chaque semaine, mais il était manifestement connu, et il est même permis de se demander si cette relation avec nos services de police ne lui avait pas permis d’éviter des problèmes judiciaires (affaire de la plainte pour séquestration, par exemple) ou de financer une partie de ses activités. Alors, indic ? « Contact utile » ? « Point d’entrée » ? Il avait quand même le numéro de téléphone d’au moins un policier en sa possession quelques heures avant sa mort.
Mais alors, me direz-vous, puisque la question est lancinante, comment est-il possible, alors qu’il était parfaitement identifié par la police, qu’il ait pu faire ce qu’il a fait à Toulouse et Montauban ?
Ecartons d’entrée la thèse de la manipulation électorale, à la fois idiote, insultante et irréaliste, pour nous concentrer sur le cœur du problème, qui constitue le fiasco le plus inquiétant. Si les policiers de Toulouse n’ont, apparemment, rien vu venir, si le RAID est parti à l’assaut de Merah comme on tente de circonvenir un chômeur en fin de droit qui hurle son désespoir ou un père divorcé privé de ses enfants, c’est bien que l’évaluation de la situation était erronée. Pardon, je reformule : complètement à côté de la plaque.
Encore une fois, comment Mohamed Merah, avec le parcours et les convictions qui étaient les siens, a-t-il pu abuser aussi aisément son traitant et l’équipe chargée de le surveiller ? Ne doit-on pas envisager, à ce point du système administratif qui était censé évaluer sa dangerosité, une authentique défaillance ? Le traitant a-t-il été naïf ? Sa hiérarchie l’a-t-elle été tout autant ? Qui a lu les rapports rédigés après les entrevues ? Qui les a validés en concluant que Merah n’était pas bien méchant et qu’il était, bon an mal an, sous contrôle ? Qui l’a traité comme on traite une petite frappe qui propose de l’herbe près de la fac ? Qui n’a vu en lui qu’un jeune Maghrébin un peu énervé mais sans envergure ? Si les rapports avaient été correctement évalués, n’aurait-on pas pu éviter le pire ?
Dans un service de renseignement digne de ce nom, le traitant d’un contact, et plus encore celui d’une véritable source, recrutée, rédige des rapports après chaque entrevue. Ce premier exercice, correctement réalisé, lui permet déjà de prendre de la hauteur et d’évaluer, non pas tant ce qui a été dit mais la façon dont ça a été dit. Qu’a-t-on appris sur la source ? Son attitude, ses envies, ses peurs, sa famille, ses besoins ? Ce rapport est lu par d’autres, dans des structures de contrôle de ces opérations, et eux aussi se posent des questions. Qui manipule qui ? La source est-elle tenue ? Quelles sont ses relations réelles avec le traitant ? Y a-t-il un risque de manipulation inverse, c’est-à-dire d’intoxication ? La source ne dit-elle au traitant que ce qu’il veut entendre ? Et faut-il changer ce traitant, justement, devenu trop proche, ou pas au niveau, ou sans imagination, ou tellement bercé par ses certitudes qu’il n’envisage même pas qu’on puisse lui mentir ?
Le renseignement, comme la charcuterie, la peinture sur verre ou le droit des affaires, c’est un métier. Il ne consiste pas à se reposer sur des écoutes téléphoniques, surtout mal comprises et mal analysées, à verrouiller les enquêtes grâce à une commission rogatoire complaisamment délivrée par un magistrat sous le charme ou à ricaner dès qu’on entend une critique. Mohamed Merah était considéré comme un jeune homme brillant, exalté, courageux, désireux de se battre, et l’avoir manifestement sous-estimé, au-delà du désastre humain, pourrait bien relever de la faute professionnelle lourde. A charge aux administrations concernées et à nos nouveaux gouvernants de réaliser des audits, sans esprit de vengeance ou de chasse aux sorcières, dans ce qui pourrait être un bel exercice démocratique d’une République qu’on aimerait, enfin, irréprochable. Et si on pouvait, à l’avenir, nous épargner les auditions au Sénat des Bouvard et Pécuchet du contre-terrorisme, ça serait aussi bien, merci.
2. « Croyez-moi, les Anglais n’auront pas d’archers » (Charles VI)
Oussama Ben Laden est mort il y a un peu plus d’un an, et l’anniversaire de sa disparition a donné lieu à la publication de nombreux articles de qualité évaluant la portée de son décès, revenant sur Al Qaïda, essayant d’articuler deux ou trois idées originales. Dans Foreign Policy, dans le COMOPS Journal, dans Foreign Affairs, comme sur de nombreux blogs de qualité, on réfléchit, on débat, on tourne et retourne les questions. La publication par le CTC de West Point de 6.000 lettres découvertes à Abbottabad par les officiers de l’Empire venus dézinguer le grand dingue a alimenté un grand nombre de réflexions, comme ici, ici, ou là, par exemple.


En France, et le débat électoral ne peut en être tenu pour seul responsable, le niveau des interventions publiques est resté, sans surprise, dramatiquement bas. Faux experts, universitaires à l’extrême marge de leur domaine de compétence, journalistes plus ou moins correctement informés, on a eu droit au service minimum, sans parler des anciens dont certains feraient vraiment mieux de se taire. A-t-on jamais vu un général vaincu être consulté lors de la guerre suivante ? Et inutile de venir me parler de vision stratégique ou de perception braudélienne, ça ne prend plus.
Plus grave, infiniment plus grave, il se murmure que nos grands services, certains obsédés par les coups judiciaires, d’autres uniquement tournés vers l’opérationnel à courte vue ou les nécessaires libérations d’otages, ont lentement laissé mourir ce qui faisait l’excellence de la communauté française du renseignement : des analyses rigoureuses, fines mais globales, capables d’alimenter la réflexion des autorités politiques, de leur présenter des options, de les aider à décrypter les manœuvres des uns et des autres, et de répondre à leurs questions. Où sont passées ces analyses ? Et leurs auteurs ?
La manifeste dégradation de nos capacités d’analyse ne peut qu’entraîner une dégradation de notre souveraineté. Souvenez-vous de l’Irak. Le travail patient et rigoureux de spécialistes, associant les méthodes du contre-espionnage et une remarquable maîtrise technique, a permis à la France de s’opposer aux Etats-Unis et de contrer chacun des mensonges de l’Administration Bush. La médiocrité actuelle du débat public français sur le jihadisme et ses vecteurs violents, associée à ce qu’on devine être le vaste chantier des capacités d’analyse de nos services – et j’espère, naturellement, me tromper – ne lasse pas d’inquiéter, sans parler du refus obstiné de nombreux universitaires à échanger avec les professionnels du renseignement. En France, les rares orientalistes ayant survécu à la période d’hystérie collective du printemps 2011 ne font que ressasser les mêmes foutaises, sans avoir jamais eu réellement accès aux dossiers dont ils parlent pourtant.
Cette faiblesse, qui empêche nos autorités – et peu importe leur couleur politique – de percevoir les nouveaux développements de la lutte contre l’islamisme radical combattant, a manifestement eu des conséquences mortelles à Toulouse et à Montauban.
3. Loups solitaires, terroristes isolés, et imbéciles heureux
Quelque chose a donc raté, mais quoi ? Le profil de Mohamed Merah, sous-estimé, n’a pas été correctement évalué, et son apparente absence de liens avec des réseaux violents en Europe a peut-être conduit certains responsables à le juger avec trop de confiance. Pourtant, le parcours de Merah aurait pu attirer l’œil, en raison de ce que les services occidentaux ont appris après l’attaque de Bombay par le LeT en novembre 2008 et l’alerte en Europe occidentale en septembre 2010.
Reprenons doucement. Les premiers réseaux opérationnels déployés par Al Qaïda, aux Etats-Unis ou en Afrique de l’Est, au début des années 90, comptaient un nombre relativement élevé de membres, organisés selon le schéma, inconsciemment dicté par les événements, de cercles concentriques allant du cœur du projet aux tâches de soutien. Les différentes nationalités se conjuguaient par ailleurs assez facilement en raison du charisme et de l’autorité des chefs, sans parler du désir de servir la cause. Ces réseaux, comme ceux du GIA en 1995 en France, s’appuyaient également sur des relations personnelles et des solidarités familiales, garantes de sécurité en raison de la difficulté à pénétrer de tels systèmes. Ce fonctionnement en cercles, empirique, n’avait pas été théorisé par les idéologues ou les responsables opérationnels jihadistes et résista longtemps à l’analyse (je m’y suis risqué, bien laborieusement, ici). Un patient travail d’environnement des individus permit cependant d’identifier les logiques internes de ces réseaux, une étape indispensable avant toute opération d’infiltration.
A partir de septembre 2001, on réalisa en Europe une impressionnante série de démantèlements de réseaux, petits ou grands. Longtemps considéré comme une zone refuge, le continent avait de toute façon changé de statut, comme avaient pu le confirmer les projets avortés d’attentats contre la cathédrale de Strasbourg (Groupe de Francfort 2, décembre 2000) ou contre l’ambassade impériale à Paris (Réseau Beghal, septembre 2001). Les attentats du 11 septembre 2001, l’assassinat du commandant Massoud, ou l’attentat contre la synagogue de la Ghriba, à Djerba (Tunisie, 11 avril 2002, 21 morts) avaient ainsi été en partie organisés par des cellules européennes, ce qui montrait les limites de la stratégie sécuritaire largement suivie en Europe jusqu’à cette période – et qui avait longtemps très efficace.
Les démantèlements successifs eurent, à mon sens, trois conséquences principales. D’abord, désormais engagés dans un jihad sur tous les fronts, Al Qaïda et ses alliés s’employèrent désormais à frapper aussi en Europe. Ensuite, sous la pression des autorités, en Europe, et des actions militaires dans le vaste monde, les réseaux changèrent de nature, et les opérations furent repensées dans leur ensemble afin de ne pas exposer inutilement les membres des équipes. La sécurité des communications fut renforcée, des procédures plus professionnelles furent progressivement appliquées, et les perquisitions effectuées ne permirent plus que rarement de découvrir des éléments compromettants (il s’agit ici d’un point qui mériterait d’ailleurs un développement particulier). Enfin, la pression accrue sur les réseaux jihadistes et plus généralement sur la mouvance islamiste radicale, ainsi que les interventions militaires occidentales dans le monde arabo-musulman (Afghanistan, Irak, évidemment, mais aussi Somalie ou Yémen) entrainèrent l’apparition de sympathisants isolés désireux de participer, avec leurs moyens, au jihad.
L’attentat de la Ghriba, déjà évoqué ou le projet de Richard Reid, le sémillant shoe bomber, contre le vol AA 63 Paris-Miami du 22 décembre 2001, avaient mis en évidence la capacité de nuisance d’individus agissant seuls, après avoir été correctement formés et dirigés. Cette constatation était d’autant plus cruelle qu’un des chocs du 11 septembre, surtout dans les services, avait résidé dans la découverte de jihadistes littéralement under cover, présentant tous les signes extérieurs d’une parfaite intégration dans nos sociétés. Et personne pour porter un T-shirt siglé, comme l’agent spécial Ray Nicolette (Out of sight, 1996, Steven Soderbergh, puis Jackie Brown, 1997, Quentin Tarantino).
Dès 2002, en réalité, le FBI, qui redoutait le pire, avait vu ses craintes confirmer par l’affaire des snipers de Virginie et du Maryland – et d’ailleurs. Déjà, le 25 janvier 1993, un citoyen pakistanais sans lien avec des groupes jihadistes, Aimal Qazi, avait ouvert le feu sur le parking de la CIA, tuant deux employés de l’agence impériale. Et pour ceux qui s’émeuvent de la condamnation à 30 ans de prison par la justice pakistanaise du médecin qui a aidé à localiser Oussama Ben Laden, sachez que Qazi, finalement arrêté au Pakistan, puis condamné à mort et exécuté aux Etats-Unis en 2002, voit sa mémoire honorée au Balouchistan par un monument. Puisqu’on vous dit que ce sont des alliés, voyons. Bref, ça m’a fait plaisir, mais ça n’a rien à voir, reprenons.
Qazi, comme les tireurs de 2002, était un loup solitaire, c’est-à-dire, selon l’expression même utilisée par les ravagés de l’extrême droite américaine, un homme agissant seul, sans connexion avec une organisation, ne donnant ni ne recevant d’ordre. Je conseille à cet égard la lecture de cette étude, et je ricane encore en pensant aux aberrations racontées par, notamment, Daniel Martin lors de son audition au Sénat, le 3 avril dernier – et dont vous pourrez lire des extraits sur le compte Twitter de la Haute assemblée (@Senat_direct). L’homme seul, qu’il soit dans la foule ou pas, est évidemment la hantise des services de sécurité, et un mode d’action privilégié par le monde du renseignement. Connecté à une organisation ou capable de s’activer seul, il constitue un défi majeur. Dans le monde du contre-espionnage, de tels individus, quand ils sont implantés de longue date, sont qualifiés d’agents dormants, de clandestins, voire d’illégaux dans la nomenclature des services soviétiques (désormais russes), qui s’y connaissent.
Les premières réflexions réalisées après le 11 septembre ont, un temps, laissé penser que Mohamed Atta et ses petits camarades étaient de véritables clandestins. Il n’en était, en réalité, rien, car un tel vocabulaire ne s’applique qu’à de longues opérations, étalées sur plusieurs années. Dans le cas des terroristes de Londres, Bali, New York ou Moscou, les terroristes n’étaient entrés dans la clandestinité que lors de la phase finale, opérationnelle, de leur projet, de façon très classique et mille fois observée.
Entre les loups solitaires, hommes seuls autoradicalisés et les individus envoyés en mission solitaire est apparue, à partir de 2003/2004, une catégorie intermédiaire, que les services français classèrent dans le 3e cercle de leur fameuse théorie des 3 cercles. Dans ce 3e cercle du jihad se trouvent les groupes et réseaux inspirés par Al Qaïda mais sans lien avec l’organisation, ses responsables et ses jihadistes. L’exemple le plus fameux a été le groupe de Hofstad qui, aux Pays-Bas, fut responsable de l’assassinat en pleine rue du cinéaste Théo Van Gogh et qui planifiait, avant son démantèlement, des attentats contre des parlementaires.
L’apparition de ces jihadistes sans attache fut une bénédiction pour Al Qaïda, qui y vit la preuve que son combat faisait des émules, et une malédiction pour les services et les autorités, confrontés à l’expression violente d’un manifeste échec socio-politique et forcés de relever le défi de surveiller, dans le respect de la loi, des radicaux potentiels qui n’avaient encore commis aucun crime. Comme me le fit remarquer un policier français en 2006, en l’absence de tout élément incriminant découvert lors de la plupart des perquisitions, il fallait commencer les interrogatoires par une question, « Etes-vous un islamiste radical ? » qui aurait pu relever du délit d’opinion. Cette relative impuissance de l’appareil judiciaire avant la perpétration d’un crime donnait encore plus d’importance au travail de renseignement en amont, afin de cerner au plus vite les acteurs de la menace.
Conscients de l’évolution de la posture sécuritaire des pays occidentaux, les jihadistes s’adaptèrent à leur tour, apportant une nouvelle contribution au duel sans fin entre le glaive et le bouclier. Dès les années 90, Oussama Ben Laden lui-même avait appelé au recrutement et à l’emploi de « jeunes musulmans occidentalisés » à même de tromper la vigilance des services intérieurs – et de provoquer des tensions sociales. Les membres d’Al Qaïda dans la Péninsule Arabique (AQPA), Al Qaïda en Irak/Etat islamique d’Irak, les Taliban pakistanais du TTP ou les Shebab ne s’y sont pas trompés en faisant appel à de jeunes hommes parfaitement à l’aise dans les pays occidentaux afin d’y conduire des attentats. Même ratés (Vol Amsterdam-Detroit en décembre 2009, New York en mai 2010, Stockholm en décembre 2010, etc.), ces actions ont contribué à placer les services de sécurité sous pression et à accroître la suspicion.
Le raid jihadiste sur Bombay en novembre 2008, une opération en tous points remarquable, a confirmé que le bon docteur Zawhiry avait réussi l’alliance du jihad global avec les jihads globaux, dans ce que j’avais pompeusement appelé le new model jihad, à l’occasion d’un post dont les deux dernières phrases se sont révélées tristement prophétiques.
Des attaques contre des villes riches regorgeant de cibles par des hommes bien entraînés sont la hantise des services de sécurité comme des services de secours, qui commencent à réaliser qu’ils sont devenus des objectifs majeurs pour des terroristes désireux de semer le chaos. L’idée mise en œuvre à Bombay en 2008 a été reprise en 2010 par les garçons du Mouvement Islamique d’Ouzbékistan (MIO), de l’Union du Jihad Islamique (UJI) et leurs amis du Jund Al Khilafah (tiens tiens, comme on se retrouve), tous membres de ce que nous sommes quelques uns à appeler l’arc de crise turcophone, qui va du Caucase à Xinjiang – où opère le follement romantique Front Islamique du Turkestan Oriental. Ces ambitieux jeunes gens, étroitement liés à Al Qaïda (vous savez, ce truc qui n’existe pas), avaient alors utilisé leurs réseaux en Allemagne pour préparer dans plusieurs villes européennes un Bombay like – une affaire déjà évoquée ici, justement à propos de Mohamed Merah. Les plus acharnés d’entre vous pourront consulter ce passionnant article, qui décrit à merveille les réseaux du MIO et de ses alliés.

Le professionnalisme croissant des jihadistes a par ailleurs été révélé, pour ceux qui en doutaient, dans les documents rendus publics lors de récents procès en Allemagne (comme ici), dans lesquels on apprend, par exemple, que Younès Al Mauritani appelait à la réalisation d’attaques dans des villes occidentales à l’aide d’une poignée de combattants afin de créer la panique et entraîner une répression accrue… Oui oui, moi aussi ça me dit quelque chose…
Alors, quelles conclusions tirer de tout ça ?
D’abord, Mohamed Merah a été cruellement sous-estimé, pris pour un jeune homme sans envergure, et certaines phrases écrites par les policiers sont sidérantes de candeur.
Et non seulement il a été mal jugé sur le terrain par ceux qui étaient censés suivre son dossier, mais à aucun moment il n’a, semble-t-il, été envisagé qu’il ait pu manipuler ses interlocuteurs. Pourtant, et de plus en plus d’affaires nous le montrent, le contre-terrorisme s’inscrit désormais dans la durée, et la lutte contre les réseaux jihadistes devrait faire appel aux méthodes éprouvées du contre-espionnage. D’ailleurs, en 1998, Edward Zwick, dans Couvre-feu, prévoyait parfaitement l’affaire Merah.

Face à des terroristes qui n’ont rien à voir avec les hordes chevelues qui égorgeaient dans la Mitidja en 1997, il convient d’être un peu malin, les amis. A cet égard, je ne sais quoi répondre à ceux qui osent encore dire que rien ne pouvait confirmer que Mohamed Merah était un islamiste radical dangereux, puisqu’il ne portait pas la barbe et ne psalmodiait pas continuellement Dieu est grand. Franchement, si vous en êtes encore là, c’est à pleurer. Les jihadistes sont conscients des méthodes employées contre eux, et ils diffusent même (ici) quelques recettes pour détecter les sources qu’on leur envoie… Alors, seraient-ils devenus meilleurs que nous au petit jeu du « qui espionne qui » ?
Les erreurs manifestement commises par certains, à Toulouse ou ailleurs, ne doivent-elles pas être reliées à la baisse de qualité de nos analyses ? Parmi les gestionnaires de ce dossier, combien avaient en tête l’affaire de l’agent-double jordanien qui tua en Afghanistan 7 membres de la CIA, en décembre 2009, après une remarquable opération d’infiltration/intoxication ? (Cf. cet article, notamment). Qui a suivi les avancées des réseaux turcophones inféodés à Al Qaïda ? Et si Mohamed Merah, comme la seconde revendication évoquée plus haut le suggère, avait bien été un terroriste revenu en Europe y semer la terreur ? Et s’il avait récupéré ses 7 fameuses armes auprès d’un contact en France prépositionné afin d’y soutenir un commando du type de celui observé à Bombay ?
Il ne faut pas céder à la manie des réformes, mais il faut relancer les machines, revenir à l’humble et acharné travail de terrain et d’analyse, celui qui casse les certitudes, qui explore des pistes, qui ose proposer ou dire non. Deux mois après l’affaire Merah, le constat est sévère, et on dirait bien que nous n’avons jamais été aussi exposés. Nous qui pensions être parmi les meilleurs, nous voilà douchés par un sanglant raté. Pour l’heure, seules les frappes de l’Empire sur les jihadistes ouzbèkes nous sauvent – peut-être.
La question du retrait d’Afghanistan est tranchée. Celle qui devrait se poser désormais est celle de notre futur retour dans ce pays, ou au Pakistan, d’ailleurs, si nous ne parvenons pas à retrouver notre niveau d’excellence. Allez donc expliquer à nos concitoyens, quand les rues de Paris, Lyon ou Bordeaux ressembleront à celles de Bombay et que les crèches brûleront, qu’il ne faut pas tomber dans le piège…